Casser Internet
Thibault Prévost - - Clic gauche - 48 commentairesUn brouillard informationnel inédit recouvre les bombardements de Gaza. À rebours de leur mythologie émancipatrice post-Printemps arabes, les réseaux sociaux ont détruit l'écosystème de l'information. Et à la fin, c'est la colonisation numérique qui gagne.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie numérique lointaine qui ressemble furieusement à la nôtre, le Web des réseaux sociaux était un pays de cocagne, où régnait un techno-optimisme débridé. Les soulèvements populaires de 2011 en Tunisie et en Égypte inventaient un nouveau paradigme informationnel : grâce à l'Internet mobile, à Facebook et à Twitter, il était désormais possible d'entendre et de voir par-delà la censure des régimes autoritaires. Chaque individu pouvait se transformer en citizen journalist, documentant les injustices et les exactions en 140 caractères. Les multinationales étasuniennes de la tech n'étaient plus seulement des plateformes d'échange de contenu viral et divertissant mais des outils de libération de l'information et des fournisseurs de Bien, qui allaient bientôt permettre au reste du monde (comprendre : le Sud global) d'accéder à la démocratie et au pluralisme d'idées. Les plateformes émancipatrices du "Web 2.0" allaient s'autoréguler et devenir des havres de débat dynamique et sain, où tous les peuples du monde pourraient se rejoindre pour former le village global informationnel rêvé à la fin du millénaire.

Une décennie plus tard, nous n'avons même plus le luxe de nous vautrer dans ce genre de mensonge. Sur les réseaux sociaux, le brouillard de la guerre ne se dissipe plus ; pire, il semble constamment s'épaissir. Il est impossible de savoir comment l'histoire analysera l'impact des événements du 7 octobre sur l'écosystème de l'information en ligne, mais il est certain que nous assistons, sidérés, à la fin d'un processus de destruction de la réalité consensuelle, en accélération constante depuis 2016. Se connecter à X (ex-Twitter), c'est accepter de prendre part, plus ou moins activement, à un moment paroxysmique de fragmentation du réel et de recomposition de l'espace social. Le brouillard de la guerre n'y est pas seulement épais, il est hallucinogène. Les structures de soutien du réel, fragilisées par la pandémie et la guerre en Ukraine, se sont effondrées sous le poids d'un volume de désinformation inédit. À tel point que même chez les grands quotidiens comme le New York Times ou le Washington Post, artisans séculaires du consensus politique, on admet désormais ne plus être capable de séparer la réalité de la fiction.

Les fact-checkeurs se noient
Nous vivons un moment eschatologique de l'information. Nous n'avons jamais connu une chose pareille, une telle violence, une telle confusion, une telle démultiplication des réalités. Blitzkrieg sur nos psychés. On s'est habitués, pourtant, à l'entrée de la guerre dans la société de l'information. La guerre en direct à la téloche, on connaît depuis 1990 et CNN qui diffuse depuis le Golfe. La guerre en direct sur les réseaux, les images du front filmées pour TikTok et repackagées en mèmes, la propagande militaire virale, démultipliée, totale, qui vient polluer jusqu'aux jeux pour enfants que sont Minecraft et Roblox, on a découvert avec l'Ukraine. Et on s'est félicités, alors, de la capacité de "résistance numérique" inattendue des Ukrainiens face à l'industrie russe de la fake news. Propagande contre propagande, la situation restait encore assez claire.
Ne reste plus alors que du commentaire, de l'interprétation à chaud, prétexte à toutes les déjections de la pensée.
Cette fois-ci, les choses sont différentes. Non seulement le volume de propagande numérique est inédit, mais la quantité de désinformation qui l'accompagne semble tout aussi monstrueuse. Twitter est devenu un monde parallèle, une dimension alternative où la fiabilité des sources est inversement proportionnelle à la diffusion de leurs informations. Pendant que les journalistes présents sur le terrain sont invisibilisé·es par le régime algorithmique, les "informations" fournies par les comptes "vérifiés", qui produisent 75% de la désinformation autour des événements, sont mises en avant - et tant pis si elles sont anciennes, proviennent d'autres lieux, d'autres époques, voire même de jeux vidéo toujours plus proches du photo-réalisme, pourvu que la personne qui les poste ait payé au préalable. Le réel est signalé comme de la mise en scène et le mensonger est repris verbatim par les dirigeants politiques. Pire, les contrôleurs qualité autoproclamés de l'information en ligne – journalistes, fact-checkeur.euses, chercheur.euses OSINT (spécialisés dans la recherche et le traitement d'informations en accès libre) – ont l'air aussi dépassés que le twittos lambda. Certains comptes d'OSINT "vérifiés" utilisent même leur réputation de fact-checkeurs pour monétiser du contenu, révèle 404Media. La confusion est totale, la réalité désertique. Le medium est bel et bien le message.
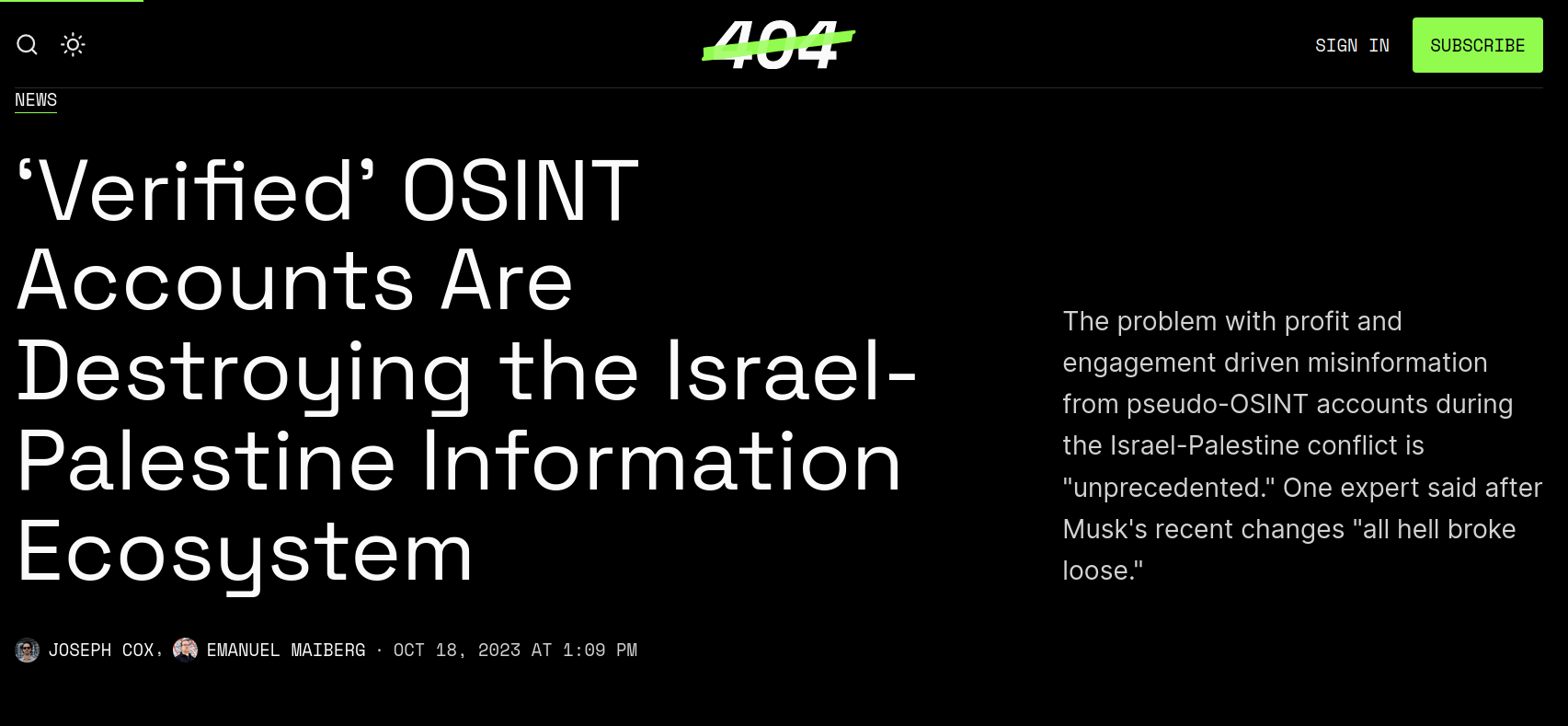
Ne
reste plus alors que du commentaire, de l'interprétation à chaud, prétexte à toutes les déjections de la pensée. Nos flux sont des cascades d'atrocités éternelles. Tout semble irrémédiablement pollué, salopé, dégradé. L'information en ligne. Notre capacité de
compréhension du monde. Notre santé mentale. Notre agentivité collective. Nous restons là, à doomscroller jusqu'à la nausée, le désespoir, l'angoisse. Jusqu'au burnout informationnel. À dériver hébétés sur nos îlots individuels, chacun dans sa monade d'angoisse et de stupéfaction, flottant dans l'archipel du réel. La course à l'engagement, la marchandisation de la souffrance et la baston permanente pour la captation de l'attention ont fini par nous bouffer. Il y a dix ans, quand on faisait encore collectivement mumuse dans les laboratoires de la viralité, l'objectif était de "casser Internet" avec la vidéo la plus surprenante possible. On ne parlait pas encore de post-vérité, de fermes à trolls, de deepfakes et de rabbit holes. Par leur combinaison de cynisme, de négligence et d'irresponsabilité, Twitter et Meta ont cassé Internet.
La question n'était pas de savoir si ça allait arriver, mais quand. Depuis la fin de la pandémie, Meta (maison-mère de Facebook et Instagram) et Twitter ont abandonné toute prétention à agir comme des plateformes d'information fiables. Depuis sa reprise par Elon Musk, Twitter a licencié une bonne partie de son équipe de modération des contenus, supprimé les titres des articles partagés sur la plateforme et mis en avant les "Community Notes", un système de modération collectif autogéré, inspiré du fonctionnement de Wikipédia, et censé apporter du "contexte" aux informations. Si le dispositif s'est révélé efficace pour lutter contre les mensonges de la publicité déguisée et des arnaques en ligne, il devient dérisoire face à une machine de propagande à échelle industrielle. Pour reprendre les mots de Damien Leloup, journaliste au Monde devenu "arbitre de la vérité" le temps d'une semaine, "aucune quantité de «contexte supplémentaire» ne règle le problème d'acteurs qui publient, intentionnellement et industriellement, des messages dont le but premier est de tromper leurs lecteurs pour un gain financier ou politique." Sans surprise, une enquête de Wiredrévélait le 17 octobre que l'outil "ne fonctionne pas comme prévu, est vulnérable aux opérations de manipulation coordonnées et manque de transparence." Du côté de Meta, on ne s'encombre même plus de ce genre d'initiative: pris dans une suite de scandales sans fin depuis 2016, le groupe a d'abord monté un "centre d'opérations spéciales" composé de modérateurices arabophones et hébréophones, avant de limiter purement et simplement l'accès à l'information relative à la situation. Pas le choix. Entre mars et mai, le groupe a licencié près de 10 000 employés (en tout, ce sont 21 000 postes de moins depuis l'automne 2022), parmi lesquels de très nombreux modérateurs de contenu. La philosophie affichée : "Faire mieux avec moins". Raté.

Ferme boutique, Elon
Ce que révèle le traitement numérique de l'opération militaire à Gaza, c'est un désengagement moral (autant que matériel) des plateformes du Web social, qui se sont longtemps rêvées (et présentées) en accélérateurs de démocratie. À l'heure de rivaliser avec TikTok, il n'est plus question d'informer mais de divertir ; il n'est plus question de modération mais plus que jamais d'"engagement" - et tant pis pour les conséquences sur la réalité collective. Comme le résume Bloomberg, "l'ère de l'idéalisme est révolue", et ce au pire moment possible. Sous le nouveau régime algorithmique, le confusionnisme est une stratégie de viralité comme les autres. Tout devient bon pour "casser Internet", y compris instrumentaliser et mettre en scène la souffrance la plus abjecte dans le format de l'époque - des vidéos verticales toujours plus courtes, accompagnées de texte, pour un maximum "d'engagement". Des instantanés génériques, décontextualisés, garantis recyclables au prochain affrontement. Du contenu habillé comme de l'info. Le massacre, un sludge content comme un autre dans la grande guerre de l'attention numérique.
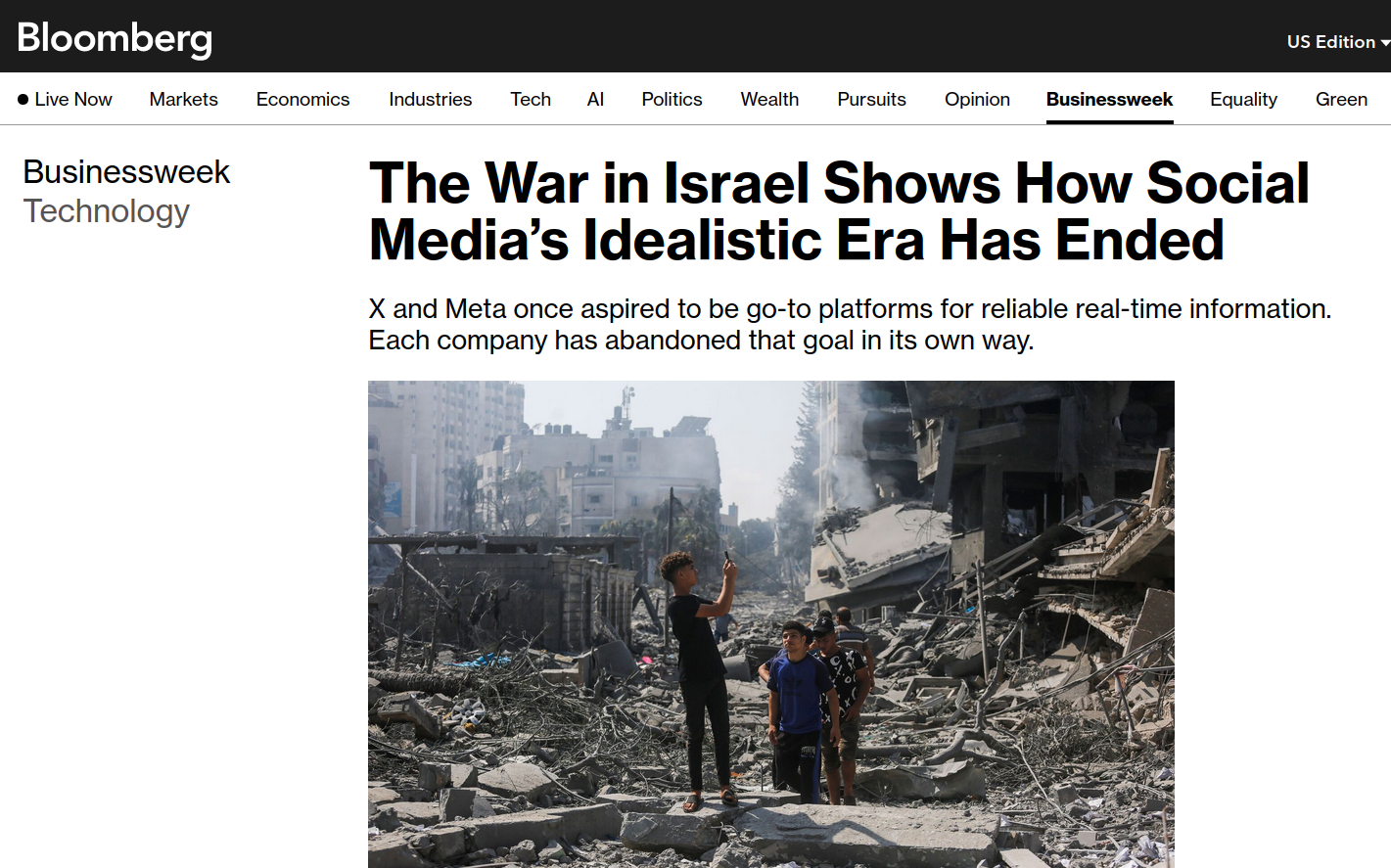
Est-il seulement possible d'enrayer l'effondrement ? L'Union européenne, impatiente de tester son nouveau Digital Services Act, semble encore y croire, et vient de poser un ultimatum à Twitter et TikTok : suppression des contenus violents et de la désinformation sous 24 heures, sous peine d'amende salée. On rigole. La rumeur enfle, on parle d'une fermeture pure et simple de X (ex-Twitter) en Europe. Elon Musk dément, trop tard : sur X, la fake news est accueillie par une standing ovation numérique. Chiche. Fais-le, Elon, ferme boutique. Libère-nous. Nous n'en sommes plus capables, accros que nous sommes devenus au close-up, à la promiscuité du gore, convaincus de la proportionnalité entre authenticité et horreur. Il n'y a peut-être que de cette manière, en débranchant les machines à sidération, que nous pourrons reprendre un tant soit peu de contrôle sur nos pensées. Nous sommes au-delà du concept de surinformation, et nous ne pouvons pas tenir à ce rythme sans que nos synapses ne se consument.
Médiatiquement, la question est entendue. Toutes les vies n'ont pas la même valeur.
Puisque les plateformes ne fermeront pas de leur plein gré, il nous faut maintenant désapprendre nos repères, déconstruire ce que nous avons bâti depuis dix ans. Réaliser que nous avons été trompés ; que Twitter, Facebook et Instagram sont aussi néfastes pour le pluralisme de l'information que pour le corps social et la santé mentale. Tant que les flux de contenu continueront à défiler, nous resterons prisonnier d'un maelström de propagande qui servira toujours les mêmes intérêts. Ceux du plus fort, du mieux équipé, du mieux financé. Sous le brouillard informationnel, dans le champ de bataille immodéré qu'est désormais le Web social, le rapport de force entre l'État colonisateur et le territoire colonisé n'a pas bougé d'un iota. Gaza s'effondre sous des averses de bombes, et nous avons intérêt à soutenir (et inconditionnellement, même) les artilleurs de Netanyahu. Dans un écosystème numérique aussi dégradé que celui que nous vivons actuellement, la guerre des récits – et non pas des "narratifs", cet anglicisme dégueulasse dont l'époque s'est entichée – est largement remportée par Israël.
Médiatiquement, la question est entendue. Toutes les vies n'ont pas la même valeur. "Un nettoyage ethnique a cours sous nos yeux. Ne pas le dire c'est y
prendre part. Chaque silence vaut blanc-seing", écrivent Kaoutar Harchi et Joseph Andras dans Frustration. L'Europe est une industrie du silence. Un exemple : dans le groupe de presse allemand Axel Springer, la profession de foi inclut explicitement la défense du "droit à l'existence de l'État d'Israël". Message reçu : selon The Intercept, les journalistes d'Upday, le plus grand agrégateur d'actualités d'Europe, propriété d'Axel Springer, sont priés de présenter l'opération militaire sous un jour favorable au gouvernement israélien. La situation hexagonale est encore pire d'unanimisme. Comme le résume superbement Frédéric Lordon sur son blog, "le bloc bourgeois français est plus israélien que les Israéliens : il refuse qu'on dise «apartheid» alors que des officiels israéliens le disent, il refuse de dire «État raciste» alors qu'une partie de la gauche israélienne le dit, et qu'elle dit même parfois bien davantage, il refuse de dire la responsabilité écrasante du gouvernement israélien alors qu'Haaretz le dit,
il refuse de dire la politique continûment mortifère des gouvernements
israéliens alors qu'une kyrielle d'officiers supérieurs israéliens le disent, il refuse de dire «crimes de guerre» pour le Hamas alors que l'ONU et le droit international le disent." Soutien inconditionnel.
Enclave physique, enclave numérique
Alors que le bombardement de Gaza par l'armée israélienne s'intensifie
en préparation d'une invasion terrestre, et face à un bloc médiatique en rangs serrés pour absoudre les massacreurs, la question de qui peut poster
quel contenu sur quelle plateforme va devenir de plus en plus centrale. Or une fois de plus, les rapports de force numériques reflètent et prolongent les rapports de force physiques. La bande de Gaza se dédouble sur Internet, enclavée et harcelée par une superpuissance cyber aux moyens d'action colossaux. L'inégalité est d'abord matérielle. Depuis 80 ans que dure le martyre de l'occupation palestinienne, le territoire et ses deux millions d'habitants sont un véritable laboratoire pour l'industrie de la surveillance israélienne, comme l'explique le journaliste Anthony Loewenstein dans The Palestine Laboratory. Notamment celle de la reconnaissance faciale automatisée, qui transforme Gaza en panoptique sordide et exporte ensuite ses outils les plus efficaces chez les grandes démocraties occidentales. Ainsi du célèbre logiciel espion Pegasus, capable de siphonner discrètement toutes les données d'un téléphone portable, commercialisé par la firme NSO Group et utilisé par une soixantaine d'États. Ainsi de la firme de reconnaissance faciale Au10tix, qui sera bientôt utilisée par Twitter pour authentifier les nouveaux utilisateurs par biométrie. Merci aux cobayes palestiniens.
Alors que les grandes métropoles israéliennes s'habituent à une couverture mobile 5G, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de Gaza ne peuvent fournir que du réseau 2G, une technologie obsolète et peu sécurisée dont la lenteur rend quasi impossible la publication de vidéos. Seules les zones frontalières d'Israël permettent un accès à la 3G et la 4G, via des FAI israéliens. Et la situation a largement empiré depuis le 7 octobre, détaille CNN : suite à des bombardements israéliens, la couverture Internet du territoire est passée de 95% à 58%. Sur les neuf FAI locaux, huit ont cessé de fonctionner. Le dernier réseau local en fonctionnement, Paltel, anticipe un "blackout total" si ses câbles transitant par l'Égypte et Israël venaient à être endommagés. Mais peu importe l'état du réseau mobile si les Palestiniens ne peuvent plus charger leur téléphone ou leur ordinateur : depuis l'annonce par Israël d'une "coupure totale" de l'électricité en direction de Gaza, ses habitants, habitués à 13 heures d'électricité par jour en temps normal, sont contraints de dépendre de générateurs, sans pouvoir se fournir en carburant pour les alimenter. Rappel terrible de la matérialité des réseaux de communication informatiques que nous prenons pour acquis : l'unique centrale électrique du territoire a cessé de fonctionner le 11 octobre dernier, faute d'essence.
En d'autres termes, la bande de Gaza risque de devenir un trou noir informationnel. Pour les Gazaouis aussi, Internet est cassé.

Le récit gazaoui étouffé
L'oppression ne se limite pas aux infrastructures matérielles. Pour étouffer le récit d'occupation gazaoui, l'état israélien dispose d'un véritable arsenal technique et humain dédié aux "psyops", la guerre psychologique et informationnelle. La grammaire de chaque plateforme est parfaitement maîtrisée. Le compte Twitter de l'armée israélienne, l'Israel Defence Force (IDF), qui totalise 1 million d'abonnés, est connu pour son ironie acide. Sur TikTok, les femmes soldats postent des thirst traps, des photos semi-dénudées faites pour attirer l'attention (masculine) et glorifier les opérations en cours. Entre les mèmes, les gifs de pop culture et les comptes d'ASMR à base de remontage d'armes à feu et de cirage de rangers, l'appareil israélien instrumentalise tous les formats de la viralité en ligne. Pour rallier le public occidental à sa cause, l'IDF adopte également la stratégie du "woke posturing" : sur les réseaux sociaux, l'armée poste des messages de soutien à des causes libérales labellisées "progressistes" (féminisme, soutien aux minorités LGBT, intersectionnalité), entre deux iconographies militaires. L'offensive s'étend jusque dans les couloirs du dark social : sur Telegram, canal préféré du "djihad vidéo" du Hamas pour sa modération inexistante, l'IDF emploie des blogueurs à plein temps, comme Abu Ali Express, pour diffuser sa version de l'Histoire.
Pas convaincus? Allez simplement sur Youtube.
Si vous avez récemment vu des spots de pub de 30 secondes terminant par le slogan "Stand with Israel" ("Soutenez Israël") ou le confusionniste "Hamas is ISIS" ("Le Hamas est Daech") entre les vidéos de vos youtubeurs habituels, vous pouvez remercier le Ministère des affaire étrangères israélien. Selon une enquête du Temps et l'analyse de la journaliste Sophia Smith Galer, qui s'appuie sur les chiffres du Centre pour la transparence publicitaire de Google, la campagne de propagande a coûté 7,1 millions d'euros à l'état hébreu, pour 88 publicités diffusées entre le 7 et le 19 octobre. La principale cible? Le Youtube français, où ces clips ont été diffusés 443 millions de fois. Coût de l'opération : 3,8 millions d'euros. Et l'opération ne se limite pas à l'hébergeur de vidéos : vous retrouverez ces clips de propagande sur Candy Crush, Angry Birds, Twitter et d'autres. Rien de nouveau dans le manuel de propagande numérique israélien : comme le relevait Pauline Bock ici-même le 10 octobre dernier, l'État hébreu avait déjà recours à de telles techniques en 2021. Youtube avait alors supprimé le clip, arguant qu'il ne respectait pas ses CGU.
Pour l'état colonial, produire et diffuser un récit de propagande, si puissant soit-il, n'est pas suffisant. Dans l'esprit de la guerre informationnelle menée par Israël, la version palestinienne de l'actualité doit tout simplement être effacée du Web. Depuis 2015, le ministère de la Justice israélien dispose d'une unité dédiée, la Cyber Unit, responsable de dizaines de milliers de signalements auprès de Facebook (en immense majorité), Twitter, Instagram et Youtube, réclamant la suppression de contenu pro-palestinien au nom de la lutte contre le terrorisme et l'incitation à la violence. En 2018, Facebook avait obéi 90% du temps. Si ça ne suffisait pas, le bureau du Premier ministre israélien recrute depuis 2013 des coalitions étudiantes pour mener la hasbara (propagande, en hébreu), des opérations de "diplomatie en ligne", dixit le ministère, durant lesquelles les étudiants sont payés pour signaler des contenus sur les réseaux sociaux. Mieux : jusqu'à 2022, il existait une application mobile, Act-IL, développée par d'anciens responsables du renseignement israélien, qui permettait à quiconque de s'inscrire et participer à des campagnes d'astroturfing coordonnées, notamment contre le mouvement de boycott pro-palestinien BDS.
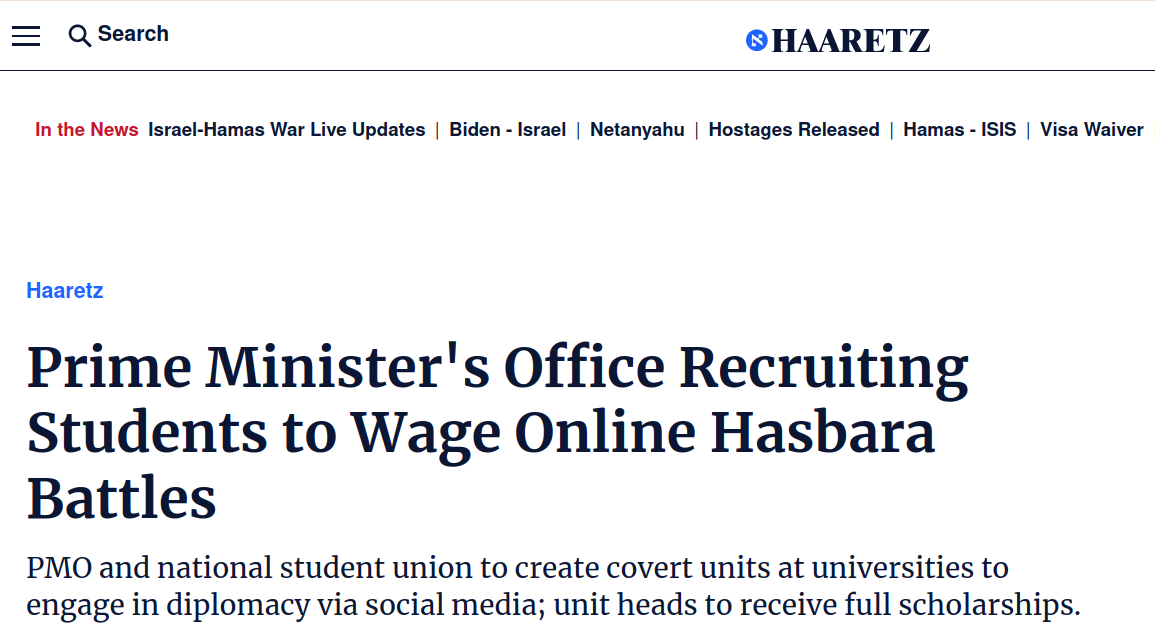
Et le soft power ne s'arrête pas là. En 2020, plus de 120 associations et lobbies israéliens faisaient pression sur Facebook pour que la plateforme, qui possède des locaux à Tel-Aviv, adopte dans sa lutte contre les contenus haineux une définition élargie de l'antisémitisme, celle de l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Cette définition de l'antisémitisme "contemporain" inclut "la négation du droit à l'auto-détermination des Juifs, notamment en affirmant que l'existence de l'Etat d'Israël serait un projet raciste". Au risque de rendre illégale la critique de la politique coloniale menée par le régime israélien. Autre exemple de l'inégalité de traitement des deux parties : Facebook organise des "sessions de consultation" avec le gouvernement israélien depuis 2016, alors que sa première réunion avec l'Autorité palestinienne date de 2021. En Israël, la nouvelle version de la "Facebook Law", votée en décembre 2021, permet au gouvernement de poursuivre les auteurs de contenus accusés de "mettre en accusation" les exactions du pouvoir. Le 18 octobre, près d'une centaine d'israéliens avaient été arrêtés et 70 étaient encore en détention suite à la publication de messages pro-Palestine sur les réseaux sociaux. Selon Ashraf Zeitoon, responsable du Moyen-Orient chez Facebook entre 2014 et 2017 interrogé en 2021 par NBC, "Israël a hacké le système et sait comment forcer Facebook à supprimer des contenus. Les Palestiniens n'ont ni la capacité, ni l'expérience, ni les ressources pour signaler le discours de haine publié par les citoyens israéliens en hébreu."
Conséquence de cette "occupation numérique" qui enrôle industrie, armée, justice, institutions et population : sur les réseaux sociaux comme dans les territoires occupés, les Palestiniens se retrouvent enfermés dans un enclos numérique, une nouvelle fois privés de leur droit à l'autodétermination. Sur Youtube, Facebook, Instagram, rien de plus facile que d'aller dans le sens occidental du "soutien inconditionnel" aux victimes du terrorisme du Hamas et à la réponse militaire et politique de Netanyahu, voire d'appeler à la paix entre les peuples. Défendre la cause palestinienne ou pire, appeler à la fin de la politique raciste menée par le gouvernement israélien peut en revanche vite valoir un strike (terrible choix de mot, dans ce contexte, que celui d' une "frappe" qui vous réduit au silence).
Tout ça n'est au fond qu'une série de bugs. Pourtant, quand Internet est cassé, c'est souvent chez les mêmes – celles et ceux qui subissent, coïncidence, un nettoyage ethnique.
En mai 2021, pendant les manifestations palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, les plateformes du Web social s'en sont donné à coeur joie. Instagram a supprimé des posts liés à la mosquée Al-Aqsa, considérés par la plateforme comme du contenu terroriste. Selon l'ONG AccessNow, des "centaines d'instances démontrent que les plateformes suppriment des hashtags de manifestations pro-palestiniens, bloquent des livestreams et suppriment des posts et des comptes", aussi bien sur Facebook que sur Twitter et Instagram. L'Electronic Frontier Foundation parle alors de "censure systémique". Mêmes plaintes en 2020, selon le rapport "Hashtag Palestine" de l'organisation de défense des droits numériques palestiniens 7amleh, et en 2022, avec les mêmes réponses des plateformes : rien à voir avec le contenu du message, mais une simple erreur technique, un glitch de rien du tout, désormais résolu. En attendant, Google Maps et Apple continuent à cartographier les colonies israéliennes illégales sur les territoires occupés de Cisjordanie, choisissant de fait de représenter le monde selon la version du pouvoir israélien. Et que fait le mouvement pro-palestinien pour protester? Il met des mauvaises notes à l'appli de Facebook sur les app stores. Dérisoire.
Comme on dit dans le monde de la tech, "ce n'est pas un bug ; c'est une caractéristique." De fait, le colonialisme numérique israélien est tellement "résolu" que depuis le 7 octobre, les mêmes bugs techniques étranges reviennent hanter les mêmes utilisateurs sur les mêmes réseaux sociaux. Instagram censure et limite la portée des posts pro-Palestine, suspend les comptes de journalistes palestiniens (comme celui du média local alternatif Mondoweiss). Twitter censure des comptes de Palestiniens, TikTok aussi. Instagram vient de "sincèrement s'excuser" d'avoir ajouté par erreur la mention "terroriste" dans les descriptions de certains utilisateurs palestiniens. Une erreur du traducteur automatique, paraît-il. Meta affirme avoir réparé un "bug" qui empêchait le contenu pro-palestinien d'être diffusé correctement. Pas de problème, alors. Tout ça n'est au fond qu'une série de bugs. Pourtant, quand Internet est cassé, c'est souvent chez les mêmes – celles et ceux qui subissent, coïncidence, un nettoyage ethnique. Celles et ceux qui tentent de résister à l'effacement, celles et ceux dont la voix nous parvient, faiblarde et distordue, entre deux glitchs, comme à travers une radio pirate. Comme l'écrivaine, journaliste et chercheuse américano-palestinienne Mariam Barghouti, qui publiait dans Rest of Worlden 2021 depuis Ramallah:
"Le blackout auquel font face les Palestiniens – qui comprend aussi bien les récits distordus de journalistes appelant cela un «conflit» que la coupure de l'accès à Internet et aux comptes de médias – ne se contente pas de supprimer nos voix individuelles. Il a pour but de nous effacer totalement, de dissimuler et de couvrir les actes criminels via lesquels Israël nous remplace par ses colonies et ses colons et nous enterre dans les abysses de l'Histoire tel un peuple de spectres."