Trump : pourquoi la presse française n'ose pas dire "fascisme"?
Pauline Bock - - Déontologie - 36 commentairesLe fascisme arrive-t-il aux États-Unis - et peut-on l'écrire ?
Concentration du pouvoir exécutif aux mains d'un seul homme, Constitution et État de droit en danger, droits humains bafoués, culte de la personnalité, déportations arbitraires à l'étranger, projet d'annexion du Groënland... Moins de trois mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la presse peine encore à qualifier précisément son action politique, qui ressemble de plus en plus clairement à celle d'un régime fasciste.
Depuis l'investiture de Donald Trump, devenu le 20 janvier le 47e président des États-Unis, la presse française cherche ses mots. Pour le décrire lui, son programme, son action, son idéologie et celle de son administration.
Une administration "inflexible", des "excès" et des "lubies"
Le 20 janvier, France Culture parlait d'une nouvelle "ère de l'incertitude"
. Une incertitude politique, a priori. Mais c'est aussi une ère de l'incertitude médiatique qui s'est ouverte : peut-on, ou non, décrire Trump et son administration comme fascistes ou pré-fascistes ? La presse ne semble pas décidée.
Dans Le Monde, par exemple, le champ lexical oscille entre une irresponsabilité établie et une instabilité constatée, sans toutefois aller jusqu'à évoquer un basculement de régime. En janvier, alors que Trump signait une série de décrets présidentiels visant à retirer des droits à des catégories de personnes (immigré.es, personnes trans...), le Monde parle de "l'onde de choc du second mandat". En mars, lorsque le président assure qu'il "ne blague pas" à propos d'un troisième mandat, ce qu'interdit la Constitution des États-Unis, le quotidien du soir se contente de souligner qu'"amender la Constitution américaine semble peu probable". En avril, alors que Trump déclare la "guerre commerciale"
sur les droits de douane,
le Monde
décrit une administration Trump faite "d'excès"
, qui fait"paniquer"
mais qui est toujours "inflexible"
. Une lettre d'un Canadien publiée comme tribune parle de "lubies"
de Donald Trump à prendre au sérieux (les "lubies"
en question : une guerre aux droits de douane, mais aussi une menace d'annexion du Canada et du Groënland) tandis qu'un édito décrit le "cynisme"
du "président milliardaire"
.
Début avril, un reportage auprès de manifestants étatsuniens qui marchent "
pour défendre la démocratie, l'environnement, les vétérans, les droits des minorités, les rangers dans les parcs nationaux, l'Ukraine, l'Etat de droit et les juges, l'assurance maladie, les immigrés arrêtés et expulsés au mépris des procédures, l'école publique, les bibliothèques et les musées"
prévient que "les gens commencent à souffrir"
de la "dérive autoritaire"
d'une administration Trump qualifiée de "bulldozer"
, ayant une "conception à géométrie variable de la liberté d'expression"
.
"Conception maximaliste des prérogatives de l'exécutif" et "autoritarisme soft"
Contrairement à la "guerre commerciale"
, expression sur laquelle se sont rapidement accordés tous les titres de presse, la presse française hésite quant au vocabulaire pour désigner Trump et son idéologie. Est-il "autoritaire"
? "Autoritariste"
? S'agit-il d'une "dérive"
? D'une "accaparation du pouvoir"
? D'un "coup d'État"
?
"Face à cette avalanche de paroles et d'actes, il est difficile de faire la distinction entre ce qui relève de la posture et ce qui constitue une mesure concrète", reconnaît Le Monde le 13 mars, en listant trois axes principaux de la politique trumpiste jusqu'alors : le démantèlement de l'État de droit, le rejet des politiques inclusives, et le durcissement de la politique migratoire. "Depuis son retour à la Maison Blanche, le 20 janvier, Donald Trump invoque la légitimité populaire pour justifier son interventionnisme tous azimuts, au nom d'une conception maximaliste des prérogatives de l'exécutif"
, résume le même journal le 5 avril. Le quotidien décrit des rassemblements de citoyens contre "ce qu'ils qualifient d'« accaparement du pouvoir »"
. Une citoyenne étatsunienne a des mots plus forts : "
J'
ai l'impression qu'il y a déjà eu un coup d'Etat ou une prise de pouvoir par des voyous qui n'en ont rien à faire du peuple."
Pouvoirs concentrés aux mains d'un seul homme, institutions démocratiques et fédérales en danger : le Figaro fait un constat similaire, mais ne parle pas non plus de fascisme. Pour le journal, qui fait un bilan, en mars, de ses deux premiers mois, Trump "bouleverse"
le monde : "Depuis deux mois qu'il est au pouvoir, le président américain, qui concentre plus de pouvoirs qu'aucun de ses prédécesseurs, s'est attaqué aux fondations de l'État fédéral et à l'équilibre mondial."
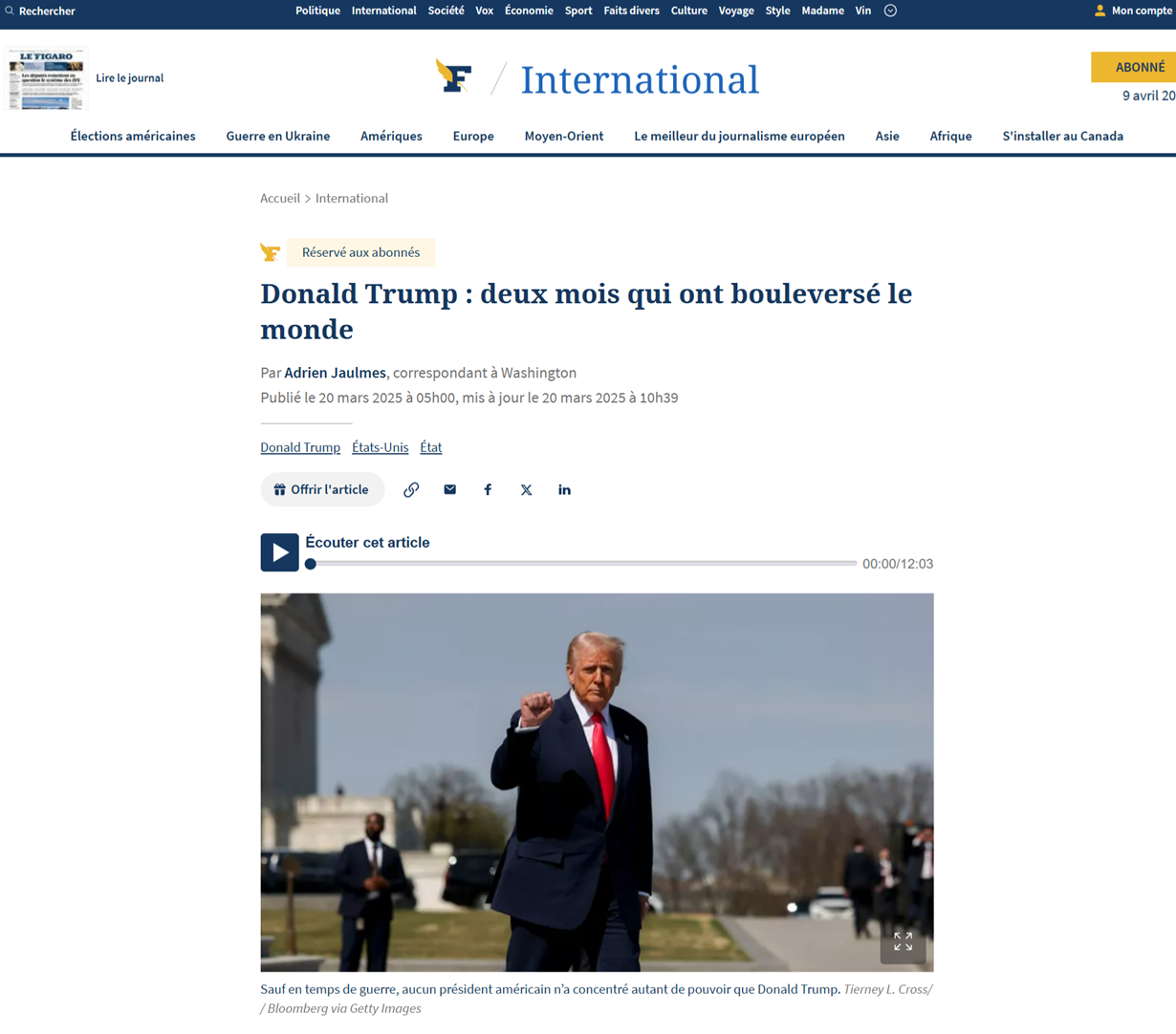
Le quotidien constate que "la révolution trumpienne est en marche"
et qu'en deux mois, Trump a "déjà transformé le visage des États-Unis"
, avec "une activité frénétique"
, a "commencé de remodeler à son image les institutions"
, et "gouverne comme il l'a toujours fait, en imposant sa vision, ses intuitions, ses convictions, mais aussi ses obsessions, ses rancunes et ses lubies".
Le Figaro
observe que "le pouvoir exécutif est plus absolu qu'il ne l'a jamais été"
, que le Congrès "est désormais impuissant"
, que la Constitution "est déjà ébranlée dans ses fondations"
, et que "Trump est le premier président à s'attaquer aux fondations mêmes de l'État fédéral"
: il semble clair que la démocratie étatsunienne est en danger. Le Figaro
use même d'une métaphore toute militaire : "Son retour ressemble à celui d'un conquérant à la tête d'une armée d'occupation prenant le contrôle d'une capitale étrangère."
Un édito du 19 mars fait le même bilan : "Le train fou de la nouvelle politique américaine est lancé à pleine vitesse, sans que l'on puisse dire ce qui, dans tout cela, est sous contrôle."
Certains articles du Figaro
saluent même l'action de l'administration Trump, lorsque celle-ci s'attaque aux combats que partage le journal. C'est le cas des musées attaqués par Trump, comme la Smithsonian institution, "accusée d'endoctrinement woke"
et "visée par un décret revanchard"
, dont le Figaro
nous dirait presque que c'est bien mérité : "Les extensions les plus récentes de la Smithsonian n'ont pas entièrement échappé aux idéologies modernes de la gauche woke, centrées sur l'identité et la race, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être prise pour cible par la contre-révolution culturelle de l'Administration Trump."

Dès octobre 2024, pourtant, dans Libération
, une tribune mettait les pieds dans le plat, en s'interrogeant : "Donald Trump est-il fasciste ?"
. Sylvie Laurent, historienne, américaniste à Sciences Po, estimait que"Donald Trump n'est ni Hitler ni Mussolini"
bien que des éléments indiscutables de fascisation, qui s'ancrent dans l'histoire américaine, sont rassemblés dans la parole et le projet politiques"
. Le 21 janvier, alors que Trump venait de prêter serment, Libération
donnait la parole à un historien qui voyait dans son projet "l'émergence d'un «autoritarisme soft» plutôt qu'une véritable dérive fasciste"
. Le quotidien a été l'un des seuls médias à ne pas hésiter à qualifier le geste d'Elon Musk de "salut nazi"
, et une tribune prévenait dès le 29 janvier que "la quête de Mars [voulue par Elon Musk] illustre une fantastique pulsion de mort inhérente à l'esprit fasciste".
Pour décrire directement l'action de l'administration Trump, en revanche, le journal préfère rester plus soft. L'introduction du dossier du quotidien consacré à Trump parle ainsi d'une "frénésie de décrets, conformément à ses promesses les plus violentes et les plus controversées"
, d'un parti républicain "à sa botte"
, de "contre-pouvoirs institutionnels affaiblis"
et d'un programme "ultra radical".
"Qualifier Trump de fasciste est une injure, pas un argument" (Les Échos)
Dès le 2 novembre, à l'aube du scrutin, les Échos
publiait une tribune considérant que "qualifier Trump de fasciste est une injure, pas un argument"
: "Ce n'est pas dans l'histoire du fascisme que l'on comprendra la popularité de Donald Trump."
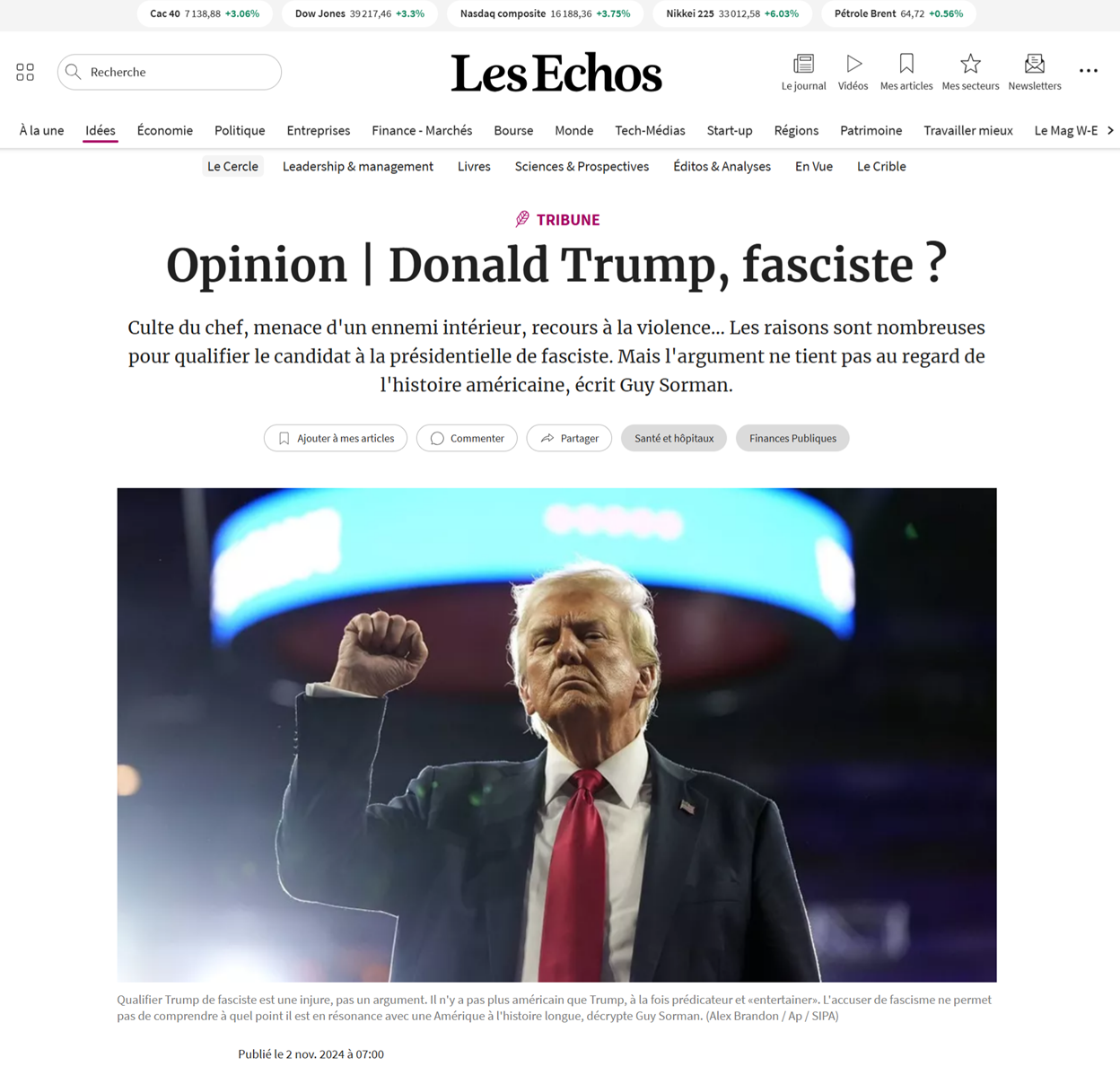
Mais ce n'est pas non plus en lisant les Échos
qu'on apprendra que son actionnaire, Bernard Arnault, qui était invité à l'investiture le 20 janvier de Trump, est un de ses amis de longue date. Le journal a depuis écrit qu'"à court terme, sa méthode [à Trump] est efficace"
et que Trump "réhabilite l'idée que la politique peut quelque chose"
: "Donald Trump incarne cette jubilation de remettre la capacité d'action, même brouillonne et contre-productive, au centre du jeu."
"Fasciste", mais entre guillemets
Rare article au moment de l'investiture de Donald Trump, en janvier 2025, à poser clairement la question : le site de Franceinfo consacre une analyse à "
pourquoi historiens et politologues sont de plus en plus nombreux à qualifier Donald Trump de
«
fasciste
»
"
- tout en laissant le mot entre guillemets. Le site voyait dans le programme trumpiste "l'intention de mettre en œuvre un programme xénophobe et risquant de fragiliser à long terme les institutions américaines"
et donnait la parole à plusieurs historiens, dont l'italien Enzo Traverso, qui déclarait : "Le fil rouge qui rattache cette constellation post-fasciste au fascisme classique, c'est la remise en cause de la démocratie."
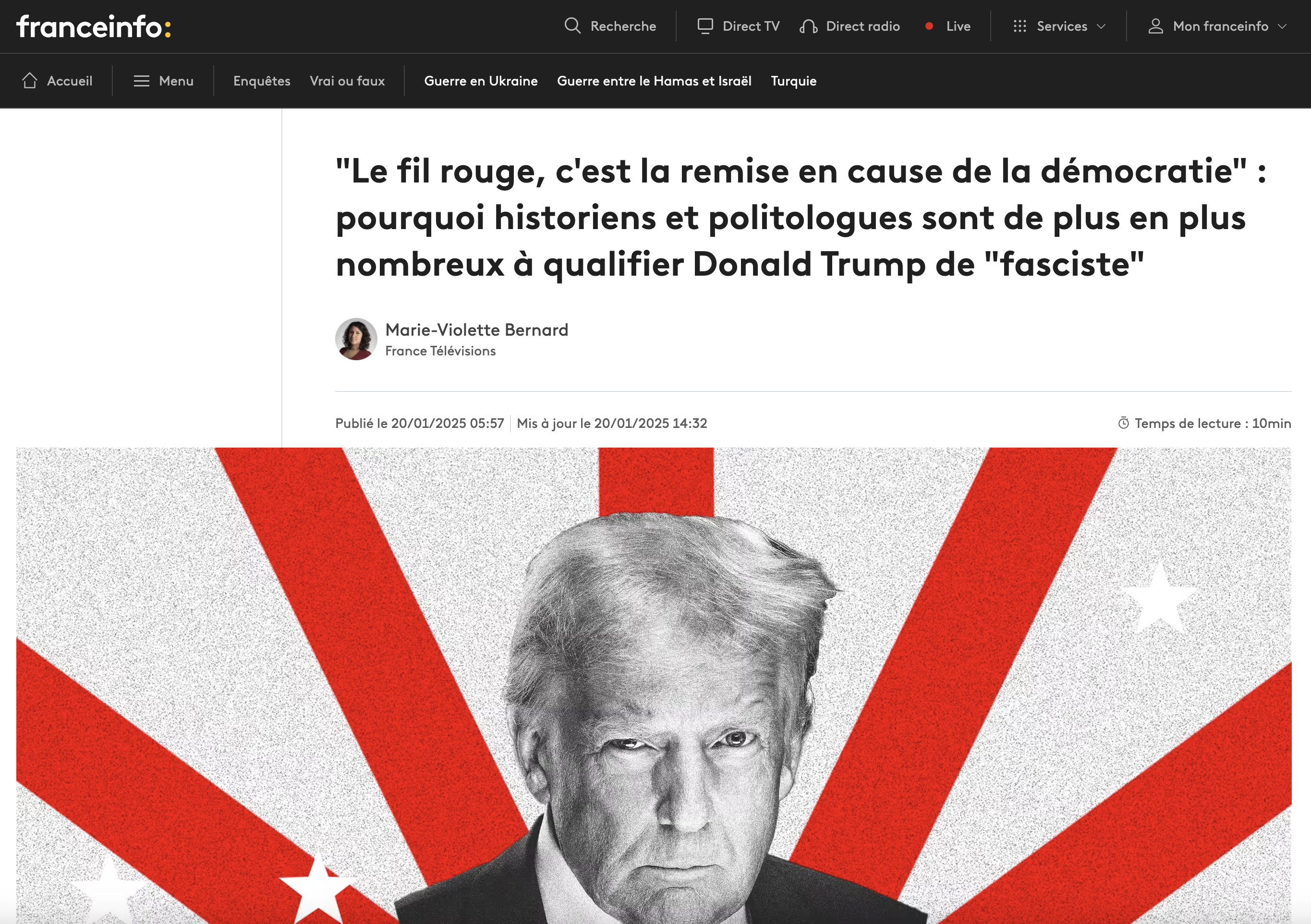
2 mars : "l'Amérique vire au fascisme" (Le Monde)
Depuis début mars, les choses bougent, doucement, dans certains titres de presse français. Une chronique publiée le 2 mars dans le Monde
, signée de l'éditorialiste Philippe Bernard, n'y va pas par quatre chemins : "Quelques semaines de la présidence Trump ont suffi pour donner au cauchemar de l'Amérique virant au fascisme un amer parfum d'actualité"
, écrit-il.

Bernard y observe "u
n ébranlement de la première puissance mondiale au puissant effet de souffle sur les démocraties européennes, qui suppose, des deux côtés de l'Atlantique, de dépasser la sidération pour poser un diagnostic juste, préalable aux ripostes"
, et donc, de s'inquiéter d'un possible "fascisme américain"
. La chronique donne largement la parole à Olivier Mannoni, auteur d'un ouvrage sur le vocabulaire du fascisme, Coulée brune :
C
omment le fascisme inonde notre langue (ed. Héloïse d'Ormesson, 2024). Celui qui a aussi traduit Mein Kampf
en français (et était invité d'ASI
en 2015 pour en parler) y déclarait voir dans l'administration Trump "l'émergence d'un fascisme américain"
.
Le 5 mars, la Croix
ouvre, de son côté, ses pages à l'historien Olivier de Frouville : il choisit comme grille de lecture les enseignements d'Umberto Eco, auteur italien de l'ouvrage Reconnaître le fascisme
, qui a vécu l'avénement du régime de Mussolini et a créé des signaux de reconnaissance du retour de l'idéologie, ce "fascisme fondamental"
. Résultat, selon de Frouville : "Trump coche presque toutes les cases du
« fascisme fondamental»"
.

Dans l'Allemagne nazie comme les États-Unis trumpistes, écrit de Frouville, "le respect du droit international est abîmé en conscience"
et provoque une "crise des organisations internationales"
. Le reste de la tribune appelle surtout à une réforme du multilatéralisme, pour ne pas dépendre des États-Unis nouvellement trumpisés. Mais le mot "fascisme"
a été clairement imprimé.
"L'aseptisation des propos"
Le 9 avril, l'édition du Monde des Livres donne enfin la parole à l'autrice étatsunienne Siri Hustvedt, qui évoque sans détour "le caractère néofasciste de l'administration Trump et du mouvement MAGA". Elle regrette notamment que face aux historiens ayant rapidement considéré que l'administration Trump pouvait être fasciste, "les médias de masse traditionnels (et de nombreux universitaires) ont avancé en guise de réponse que des comparaisons de ce type étaient « irresponsables ». Seuls des gauchistes alarmistes rattacheraient Trump à Hitler. Les Etats-Unis de 2025 ne seraient pas l’Allemagne en 1933." Pourtant, écrit-elle, "affirmer avec insistance que le mot « fascisme » ne peut s'appliquer au Parti républicain américain relève de la pensée normative" et les médias "à l'ancienne, liés aux intérêts des grandes entreprises, craignant de perdre tout accès au pouvoir et souhaitant maintenir une certaine sobriété de ton – celui de la continuité –, ont recours à la paraphrase. Les saillies racistes, xénophobes et misogynes et les discours d'une rare confusion deviennent des déclarations policées et rationnelles. La technique a un nom : le sane-washing, l'aseptisation des propos".
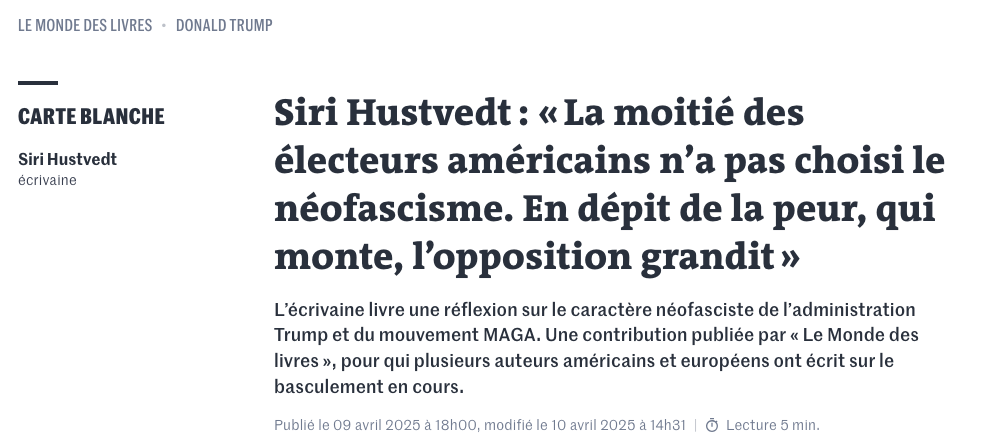
Une "timidité extrême" de la presse face à Trump
"Doucement, on commence à oser prononcer le mot"
, observe Olivier Mannoni, auteur d'un ouvrage récent sur les mots du fascisme et traducteur en français de Mein Kampf
, auprès d'Arrêt sur images
. Il estime cependant qu'"il y a une timidité extrême"
, dans la presse française, "face à ce qu'il se passe"
, et a pu l'étudier de près lors d'une invitation sur le plateau de Thomas Snégaroff pour un débat titré "Fascisme : Le grand retour ?"
, où, dit-il, "nous étions deux sur six invités à voir qu'il y avait un vrai problème : les autres nous expliquaient qu'il ne fallait pas exagérer"
. En juillet 2024, date à laquelle Mannoni a rendu le manuscrit de son ouvrage Coulée brune
, le problème était déjà flagrant, dit-il : "J'avais déjà repéré le langage nazi réutilisé chez Trump : «vermine», «éradiquer», protéger le «sang» américain de la «contamination» : ce sont des mots du langage nazi pur."
Il reconnaît aussi des similitudes dans les "loghorrées"
de Trump, qui, comme celles d'Adolf Hitler, "lui permettent de faire passer des idées inadmissibles pour le commun des mortels, mêlées à une grande brutalité"
.
"Si les médias passaient moins de temps à commenter la petite phrase, et plus de temps à commenter les faits, on verrait que oui, il y a tous les éléments d'un régime autoritaire aux accents fascisants"
, abonde auprès d'ASI
Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis.
Elle liste les signaux forts : "La remise en cause de l'État de droit, par exemple le fait d'interdire certaines professions ou certains droits à certaines personnes, comme les personnes transgenres qui n'ont plus le droit de servir dans l'armée,
les sans-abris qui n'ont plus accès à la sécurité sociale... La remise en cause de la séparation des pouvoirs, avec le fait que les décisions par décrets de Trump contreviennent à la loi et à la Constitution. Le fait que lorsque ces décrets sont attaqués en justice et mis en pause le temps d'être jugés, lui s'en fiche et continue à en signer.... Si le président ne respecte pas l'État de droit et la Constitution, c'est presque un coup d'État de l'intérieur."
Pour Olivier Mannoni, il n'y a plus de doute : "Ma théorie, c'est qu'on a déjà basculé."
Lui qui donne des cours de traduction en master précise avoir travaillé sur Trump durant son premier mandat et avoir toujours "pris des pincettes en travaillant sur le langage de Trump et d'Hitler"
. Mais les similitudes se bousculent désormais, dans les paroles et dans les actes : il y a eu l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, "un remake de la marche sur Rome de Mussolini"
; il y a cette "verticalité du pouvoir"
, avec Trump en "leader qui décide de tout"
; il y a ses déclarations sur Gaza qui deviendrait une "riviera" si l'on en déporte sa population, qui est "un crime contre l'humanité caractérisé, typiquement nazi"
; il y a les déportations de personnes sans papiers dans les prisons du régime du Salvador, "des déportations qui nous ramènent à la violence du début du nazisme"
... "Ce matin encore"
, dit-il le 9 avril 2025, "dans le Mississipi,
on a ordonné aux bibliothèques de détruire des ouvrages de recherche
. C'est du fascisme pur."
Pourtant, "la presse en général prend des pincettes pour en parler, on parle d'«autoritarisme croissant», le terme fascisme n'est pas appliqué"
, dit-il. "Le geste qu'a fait Elon Musk [le 20 janvier], c'est indiscutablement un salut nazi. Et la presse s'est demandée s'il voulait donner son cœur à la foule... Foncièrement, il y a un refus d'accepter l'idée que cette idéologie puisse revenir, d'une façon ou d'une autre."
"On est en avril, ça sautait aux yeux dès novembre"
Olivier Mannoni explique cette timidité médiatique par un "effet de sidération"
: "On vit en Europe, depuis 1945, avec l'idée que cette idéologie est morte. Et en plus, ce sont les Américains qui nous en ont libéré. Et là, ça se produit chez eux."
Marie-Cécile Naves le rejoint : "Il y a un effet de sidération, sans doute un souhait d'être prudent et de prendre le temps de l'analyse."
Si, depuis début mars et notamment après l'article du Monde
du 2 mars dans lequel il prenait la parole, Olivier Mannoni note que la presse commence à s'intéresser au sujet, il regrette le retard accumulé : "On est en avril, et ça sautait aux yeux dès novembre."
Mais les invitations médiatiques s'accumulent désormais dans son agenda - signe, selon lui, que la presse prend désormais conscience des enjeux. Marie-Cécile Naves, qui est elle aussi souvent invitée dans les médias, regrette cependant que la fameuse stratégie médiatique de l'ex-conseiller trumpiste Steve Bannon, celle "d'inonder la zone de merde"
, continue à fonctionner : "On nous appelle toujours pour commenter la petite phrase, bien plus que son agenda politique"
, dit-elle. Elle aussi commence à observer "une prise de conscience de ce qui est en train d'arriver"
dans les médias. Quand oseront-ils écrire le mot ? "Peut-être quand le Groënland sera envahi"
, répond-elle. "L'administration Trump, ils sont très sérieux là-dessus. Ils vont le faire."
À la télé, la question de la violence du régime Trump et le mot "fascisme" ne sont toujours pas évoqués, souligne Mannoni : "Il y a une forme d'autocensure. On ne veut pas choquer le public avec ça... Alors que si les choses tournent comme je crains qu'elles tournent, le public sera choqué, et plus encore parce qu'on ne lui aura pas expliqué avant."