Secession Valley
Thibault Prévost - - Numérique & datas - Clic gauche - 41 commentairesAprès avoir cherché à s'acheter des colonies dans le Sud global, l'élite de la tech réactive ses envies séparatistes au sein-même des États-Unis. Et affiche de plus en plus clairement des fantasmes suprémacistes, incarnés par le techno-prophète Balaji Srinivasan.
"California Forever". Non, ce n'est pas le nom d'un futur Ehpad de luxe option cryogénisation pour milliardaires transhumanistes, mais pas loin. California Forever, c'est le nom de code d'un étrange et opaque projet de ville privée qui se joue depuis plusieurs années dans le comté de Solano, à une centaine de kilomètres au Nord-Est de San Francisco. L'été dernier, le New York Times révélait que depuis 2017, une entreprise inconnue, Flannery Associates, avait discrètement acheté près de 25 000 hectares de terres agricoles arides, divisés en 400 parcelles. Toute résistance était futile : Flannery Associates achetait quatre à cinq fois au-dessus des prix du marché, que le terrain soit ou non listé à la vente. Coût de l'opération : 800 millions de dollars. Là, dans ces collines couvertes de lignes à haute tension et de parcs éoliens, un méga-projet commençait à prendre forme - mais quoi ? Malgré plusieurs tentatives d'investigation par la presse locale, rien n'avait filtré.
En août 2023, début de réponse. Une enquête du New York Times,
encore, révèle que Flannery Associates est dirigée par un ancien trader de Goldman Sachs, Jan Sramek, et que ses investisseurs forment le gotha du capital-risque de la Silicon Valley - Michael Moritz, Reid Hoffman, Marc Andreessen, Chris Dixon, les frères Patrick et John Collison. Leurs noms ne vous disent probablement rien, mais leurs fortunes personnelles se chiffrent en milliards de dollars, et leurs fonds d'investissement font et défont les fortunes de la Silicon Valley. Là où ils vont, la Silicon Valley va. Et leur dernière obsession, c'est de bâtir une ville idéale à partir de rien, pour les gens de leur caste. Une ville parfaite pour techies et milliardaires, connectée et écolo, où les enfants multicolores pourront jouer dans les "quartiers piétons et sécurisés" de cette "ville du quart d'heure", entre deux rangées de jolies maisons en briques alimentées à l'énergie solaire. Loin, très loin de la conurbation métastatique de Los Angeles et de la fourmilière surpeuplée de San Francisco, où ces mêmes investisseurs défendent à longueur de projet la verticalité des immeubles de bureaux, le gigantisme des centres commerciaux et le tout-bagnole.

Pour le moment, California Forever est une vision d'urbaniste, qui n'existe que sous forme de représentation archétypale. Comme tous les projets utopiques de la Silicon Valley, il oublie un peu trop facilement les réalités politiques, sociales et climatiques du monde réel : la région est particulièrement touchée par les sécheresses et les incendies. Les démiurges de la tech n'en sont d'ailleurs pas à leur première tentative de création d'une ville privée sur-mesure : outre la constellation d'horreurs crypto-coloniales à dôme géodésique posées en Amérique centrale et en Océanie, déjà cartographiée en détail dans cette chronique, la techno-élite prospecte désormais en Europe (le projet Praxis, modelé à partir de la cité-État marchande de la Renaissance, et la "ville éphémère" de Zuzalu, qui a posé ses tentes climatisées sur la côte monténégrine au printemps 2023) et jusqu'au Canada, où Google, via sa division Sidewalks Labs, a désespérément tenté d'imposer un projet de quartier connecté sur une friche portuaire de Toronto... avant de jeter l'éponge face à la contestation. Pas un mois ne se passe, nous dit The Atlantic, sans qu'un groupe de tech bros illuminés promette l'avènement d'une sorte de Sparte pour codeurs.
Comme ces tentatives foireuses, toutes bloquées quelque part entre le PowerPoint délirant et le procès interminable contre les autorités locales, California Forever n'est pas seulement un projet urbanistique : c'est un cri de rage et d'impatience, le symptôme visible d'une radicalité qui s'exprime de plus en plus bruyamment parmi certaines élites de la tech. Faire sécession, mettre les bouts, fuir, et vite. Fuir quoi ? L'impôt, l'État-Nation, la polycrise, l'administration, la presse libérale, les conséquences de leurs actes, vous, moi, les critiques... la liste est longue.

Pour certaines personnalités de la tech, pas forcément les plus médiatiques, la frustration de devoir encore composer avec le corps social et la paranoïa constante d'un soulèvement alimentent un processus de radicalisation idéologique. Et le projet hypercapitaliste classique des barons de la Silicon Valley, celui des Musk, Bezos, Zuckerberg et consorts, accueille désormais avec enthousiasme des modalités néofascistes articulées par des idéologues d'extrême-droite, encore largement inconnus sur cette rive de l'océan. Une petite musique monte, sinistre et martiale. Une ritournelle d'apartheid et de purge, sise sur la conviction suprémaciste d'une supériorité de caste, enrobée dans une couche de techno-bullshit où se mêlent IA, cryptomonnaies, web3 et autres délires. Son slogan, c'est la sentence publiée un jour de 2009 par Peter Thiel, le baron Harkonnen de la Silicon Valley, sur le site du think tank
libertarien Cato : "Je ne pense pas que le capitalisme et la démocratie soient compatibles." Entre les deux, la Silicon Valley a choisi.
En première ligne de ces nouveaux croisés, on trouve un homme appelé Balaji Srinivasan - Balaji, pour ses disciples. Peu connu en France au-delà des cercles crypto (et des lecteurs de l'excellente Nastasia Hadjaji, pourfendeuse de crypto-bullshit à plein temps), l'ancien chief technology officer de la place d'échanges Coinbase, fondateur de startups et partner au fonds d'investissements Andreessen Horowitz, est devenu une sorte de petit gourou néo-conservateur qui prêche pour "l'État-réseau", un concept de gouvernance qu'il a développé dans son manifeste éponyme, The Network State
, autopublié en 2022 - le 4 juillet, très précisément. L'État-réseau est défini comme "un pays que l'on peut démarrer depuis son ordinateur, un État qui recrute comme une start-up, une nation bâtie sur Internet", ce qui sonne dès le départ comme une idée pourrie. Elle repose sur un raisonnement absurde, selon lequel toute communauté en ligne suffisamment organisée peut devenir un État-nation comme les autres, pourvu que ses membres achètent des terres en crowdfunding et plantent des dômes géodésiques dessus. (J'exagère à peine, c'est dire le niveau.)

Le projet est d'un vide politique insondable. Dans le futur merveilleux de Balaji et de sa communauté, le monde se morcelle en une infinité d'États-réseaux que les individus souverains peuvent rejoindre selon leurs envies du moment, façon Livre dont vous êtes le héros, - une semaine chez les techno-royalistes, une semaine chez les cyberpunks, etc... Tout vote est inutile ; soit vous aimez ce qu'il se passe et vous légitimez le régime en y restant, soit vous partez. Les égoûts sont nettoyés par des fées, les pompiers sont des Télétubbies, tout le monde se nourrit de prana, les infrastructures publiques se réparent toutes seules et les orientations budgétaires apparaissent à intervalles réguliers sous forme de parchemin magique dans un coffre en or, qu'on ne trouve qu'au pied d'un double arc-en-ciel. En 2013 déjà, Balaji attirait l'attention du New York Times avec un discours d'une naïveté et d'une arrogance similaires. Devant une foule de jeunes patrons de start-up, réunis dans les locaux de l'incubateur Y Combinator, il appelait alors à quitter les États-Unis, ce "Microsoft des nations", pour "une société à opt-in gouvernée par la technologie". Consternant.
Depuis le succès de The Network State, Balaji a franchi un cap de radicalité, et les choses sont d'un seul coup devenues très concrètes : en septembre 2023, il affirmait que "ce [qu'il] défend est quelque chose de l'ordre d'un sionisme de la tech", en faveur de sa caste, les "Gris". Pour purger San Francisco des "Bleus" - vous, moi, toute personne avec un ego de taille normale -, Balaji a une idée géniale : les Gris n'ont qu'à acheter la police en organisant des banquets et en offrant du boulot à toutes les familles des agents. À la fin, promet Balaji, les flics deviendraient une sorte de garde prétorienne des Gris, uniforme inclus. Enrobez ça d'autant de blockchain et de NFT que vous voulez, on appelle ça une mafia, ou un putsch fasciste. Si vous doutiez encore, sachez que pour Balaji, le Gris ultime n'est autre... qu'Elon Musk, désormais militant d'extrême-droite à temps plein.
Pour quiconque perçoit le monde au prisme de la sociologie politique, évidemment, la vision de Balaji est un ramassis d'absurdités, qui tente désespérément de masquer des pulsions ségrégationnistes et autoritaires. Mais en 2024, être un clown et hurler des dingueries vaguement fascistes peut vous amener à la Maison-Blanche. D'autant que dans la Silicon Valley, auprès de gens richissimes fermement convaincus que la société n'est qu'une somme d'individus, qu'ils en incarnent les plus glorieux représentants et que le reste de leurs congénères veut leur ruine, l'idée touche une corde sensible. Le milliardaire réactionnaire Marc Andreessen (un homme ravi que "l'Oxycontin et les jeux vidéo fassent fermer leur gueule [aux pauvres]") l'adore, tout comme David Sacks, Max Levchin et Peter Thiel, membres de la célèbre "Paypal Mafia" et désormais aux avant-postes de la croisade réactionnaire en cours.
Parmi les fanboys de Balaji - car oui, ce sont tous des hommes-, on trouve également Garry Tan, PDG de l'incubateur de la start-up Y Combinator. Un homme influent et toxique qui soutient le génocide en cours à Gaza, souhaite publiquement une "mort lente"
aux élus démocrates de San Francisco et tente, très concrètement, de"reprendre"
la ville avec le soutien financier d'un gang de tech brosen plein cosplay fasciste, prêts à dépenser jusqu'à 15 millions de dollars dans la course à la mairie. Leur programme, qu'ils décrivent comme "modéré"
: explosion du budget de la police, emprisonnement des usagers de drogue (alors que San Francisco fait face à une épidémie d'overdoses) et investissements massifs en vidéosurveillance. Le 5 novembre, date des élections municipales, San Francisco pourrait bien devenir un laboratoire de gouvernance sécessionniste pour certains edgelords de la Silicon Valley, dans le sillage de grands patrons des Gafam visiblement excédés par la démocratie représentative. L'épicentre de la Secession Valley, cette forteresse par les riches pour les riches, d'où une poignée d'élus nous encourage à nous connecter les uns les autres depuis la réclusion de ses palais.

Si l'époque est généralement au repli identitaire et à l'illibéralisme, les pulsions séparatistes locales, néocoloniales, libertariennes, flottantes et spatiales de Balaji, Garry Tan, Marc Andreessen, Peter Thiel, Jeff Bezos ou Elon Musk n'ont rien d'inédit. Outre l'héritage sécessionniste consubstantiel à la formation des États-Unis, l'histoire de la Californie est parsemée d'expériences de villes privées comme Irvine, de zones à statut spécial comme le campus de Stanford, et de gated communities pour élites, au premier rang desquelles Beverly Hills, équipées de barbelés et de services de sécurité privée. Dans City of Quartz, paru en 1990, le légendaire sociologue urbain Mike Davis surnommait Los Angeles "Fortress L.A.", une ville composée de quartiers fortifiés, où règne la ségrégation de classe et le régime de la surveillance. Le fantasme d'une ville-État marchande n'est pas un bug, c'est une caractéristique de l'ethos
californien. Quand elle ne défend pas l'instauration d'une sorte de techno-monarque éclairé, la caste technocrate et financière actuelle, explique l'historien Quinn Slobodian dans son excellent Crack-Up Capitalism, est obsédée par le modèle de la Zone économique spéciale - en particulier Hong-Kong et Singapour, parfaites synthèses du capitalisme dérégulé, du paradis fiscal et du régime autoritaire. Tout le reste n'est que décor et science-fiction.
Il n'y a rien de nouveau. L'État-réseau, que Balaji présente à longueur de conférence comme une invention géniale, sent le réchauffé : il reprend la théorie du Patchwork, sorte de fédération de mini-pays gouvernés comme des entreprises par des PDG et des conseils d'administration, développée par le penseur néo-réactionnaire Curtis Yarvin en 2008. Yarvin et ses écrits rances vivent d'ailleurs une seconde jeunesse, écrivait Mediapart dans un passionnant papier publié mi-mars, auprès d'une Silicon Valley en pleine crise d'autoritarisme. Et il y a fort à parier que son nom finisse par apparaître dans la presse à mesure qu'enfle le mouvement techno-réactionnaire de la New Right, en pleine année d'élection présidentielle étatsunienne.

Soyez prévenus : Curtis Yarvin n'est pas n'importe qui. Véritable empereur des edgelords de la blogosphère réactionnaire dans les années 2000, il a inventé les mouvements intellectuels jumeaux de la Néoréaction et des Lumières noires, déposé le concept de "red pill"
désormais si cher à l'internationale fafoïde numérique, inspiré des stratégies mémétiques à Steve Bannon, proposé des bombardements aériens sur les quartiers pauvres de SF, affirmé que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, et toute une collection de déjections de la pensée qu'on retrouve désormais dans la section "Racisme" de sa page Wikipédia. Un authentique nazillon planqué derrière du sarcasme, dont les traités d'économie politique sont aujourd'hui exhumés et repris comme des saintes écritures par un phalanstère de tech et de crypto bros, de trolls masculinistes, d'intellos conservateurs et de marginaux du spectre politique, mais également par des gens installés à la tête d'énormes fonds d'investissements, comme le mage noir Peter Thiel. Leur ennemi commun : la "Cathédrale", le nom donné par Yarvin à l'intelligentsia libérale et progressive, qu'il accusait déjà de wokisme bien avant que le mot ne vienne exciter l'éditocratie de CNews. Une nouvelle fois, du neuf avec du vieux.
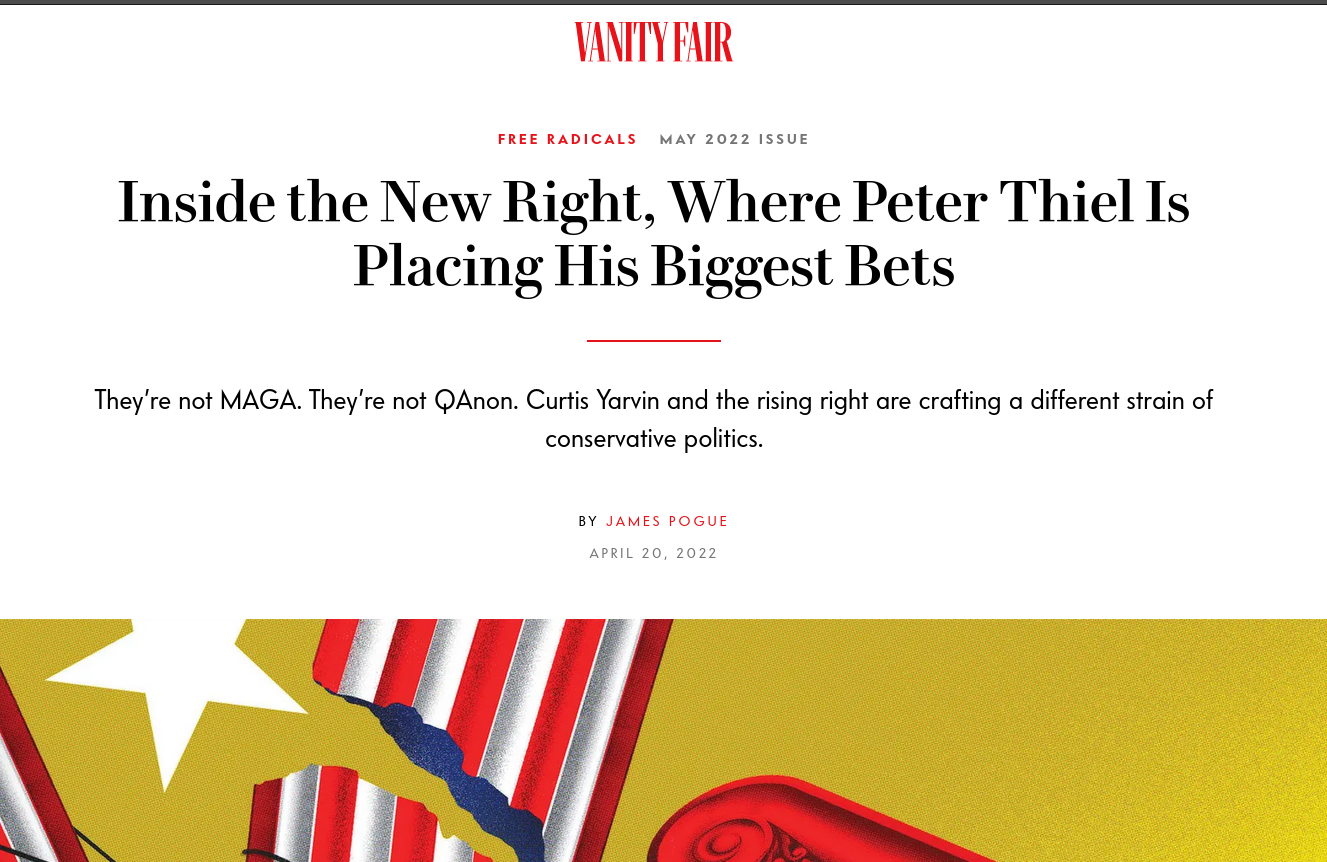
Les signes s'amoncellent. Derrière les campagnes municipales, les projets de ville nouvelle et le "sionisme de la tech", derrière cette profusion d'utopies débiles et de concepts post-apocalyptiques explorés notamment par Douglas Rushkoff dans Survival of the Richest, ce qui transpire, c'est une exaspération générale de la domination, qui se sent attaquée de toute parts lorsque les habituel·les écrasé·es ont soudainement l'outrecuidance d'essayer de vivre dignement. Depuis près d'un quart de siècle, date de la dernière loi fédérale de régulation du secteur aux États-Unis, la Silicon Valley n'a connu que l'impunité légale, l'expansion et le profit sans entraves, le sentiment de supériorité omnipotent, la négation du monde social. Son exaspération est l'expression d'une fragilité d'enfant-roi, qui ne tolère pas la moindre contrariété. Elle ne discute pas, ne négocie pas, ne s'adapte pas : elle fuit, se retranche ou détruit.
La radicalisation hallucinante qui s'opère en ce moment dans la Silicon Valley, l'émergence d'idéologues néofascistes et de visions séparatistes en parallèle d'un futurisme de plus en plus fou, n'est au fond qu'une performance. Celle d'une classe de capitalistes enragés, prêts à toutes les brutalités pour réaffirmer leur droit à exploiter. À l'heure où Hollywood matérialise avec une joie perverse (Civil War, d'Alex Garland) la menace de guerre civile qui plane sur la vie politique étatsunienne depuis 2016, et avant une élection présidentielle qui tend les bras à Donald Trump, cette fois-ci armé du master plan de la Heritage Foundation pour remplacer l'intégralité de l'administration, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir du corps social.