Rages contre les machines : Luddites, unissez-vous !
Thibault Prévost - - Numérique & datas - Clic gauche - 28 commentairesLa grève qui secoue Hollywood est tout sauf anecdotique : elle préfigure une nouvelle lutte des classes néo-luddite face à l'offensive extractiviste des propriétaires d'IA, et le refus de l'économie précarisée qui accompagne l'innovation technique.
S'il y a bien un lieu commun insupportable à l'écriture du journalisme tech, c'est la convocation de la référence pop Black Mirror pour commenter un événement d'actualité. Comparer le présent à la série d'anticipation de Netflix est au-delà du cliché, je le sais, mais parfois, la tentation est trop forte. Saison après saison, l'imaginaire prophétique de Charlie Brooker continue de se télescoper avec le réel. Dernier exemple en date : Joan is Awful, premier épisode de la saison 6 de la série. On y suit Joan, qui découvre que son quotidien est adapté automatiquement en série, au jour le jour, par un système d'IA générative opéré par Strawberry (avatar transparent de Netflix). Sidérée, humiliée puis enragée, Joan tente d'abord de poursuivre Strawberry en justice, mais son avocate lui explique qu'elle a cédé ses droits d'image à l'entreprise lors de son inscription - la condition est dissimulée quelque part au fond des CGU, que personne ne lit jamais. À l'écran, les péripéties de Joan sont incarnées par Salma Hayek... qui réalise qu'elle a, elle aussi, cédé à l'IA le droit d'utiliser son image comme elle l'entend. Joan et Salma Hayek sont toutes les deux piégées dans un dispositif technique et légal qui exploite, automatiquement et continuellement, leur image. Sans vous dévoiler aucun élément-clé de l'intrigue, disons simplement que les deux protagonistes vont rapidement découvrir les mérites de l'action directe pour s'extirper d'un système d'exploitation.
L'épisode a été diffusé par Netflix le 15 juin 2023. Un mois plus tôt, le 3 mai, la Writer's Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes d'Hollywood, se mettait en grève pour la première fois depuis 2007. Le 13 juillet dernier, un mois jour pour jour après la diffusion de Joan is Awful, le tout aussi puissant syndicat des acteurs et actrices étasunien·nes (SAG-AFTRA) se mettait à son tour en grève après l'échec des négociations avec les studios de productions (les historiques, comme Disney, NBC Universal, Paramount et Warner Bros Discovery, et les nouveaux, comme Netflix, Amazon ou Apple) réunis sous la bannière de l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP). Acteurs et scénaristes unis au piquet de grève face aux studios : la situation, qui paralyse la gigantesque industrie culturelle étasunienne, est inédite depuis 60 ans.

Des superstars hollywoodiennes aux petites mains des plateaux et des salles d'écriture, les revendications des deux syndicats sont exactement les mêmes : une meilleure redistribution des revenus du streaming, et des garanties contre le pillage de leur travail par les systèmes d'intelligence artificielle utilisés par les studios pour automatiser la production de séries et de films. Les demandes de "régulation du matériau produit grâce à l'intelligence artificielle ou des technologies similaires" émises par le syndicat des scénaristes sont
très précises : qu'aucun script, aucune pièce de théâtre, aucun dialogue
ne soit jamais rédigé par ChatGPT ou un outil similaire ; que toutes les
entités créditées soient des êtres humains ; que le travail des
scénaristes ne soit jamais utilisé comme matériau source pour l'IA
générative. De son côté, le syndicat des acteurs et actrices réclame que"les conditions d'acquisition des droits de simulation numérique des comédien·nes pour créer de nouvelles performances [soient] négociées avec le syndicat." Cette garantie, le syndicat des réalisateurs (DGA) l'a obtenue le 23 juin dernier, rappelle Vulture : en pleine négociation avec le même consortium de studios, le DGA a obtenu que "les employeurs ne pourront pas utiliser l'IA générative en connexion avec d'autres éléments sans consulter le réalisateur", et que syndicats et studios se voient deux fois par an pour discuter des dernières innovations techniques et de leurs impacts. Quant au syndicat des comédien·nes de théâtre, la IATSE, elle créait en mai une commission dédiée à l'intelligence artificielle. En amont de sa propre renégociation de contrats avec les studios prévue l'an prochain, le syndicat a publié début juillet une série de principes, qui visent à déployer l'outil dans le respect des droits des employé·es.

En toile de fond, cette grève est donc l'expression d'une angoisse existentielle profonde, partagée par toute l'industrie et formulée par la présidente du syndicat des acteurs et actrices Fran Drescher (passée d'Une nounou d'enfer au syndicalisme le plus radical) lors d'une conférence de presse ardente : "Ce qui nous arrive se produit dans tous les secteurs du travail. C'est ce qui se produit quand les employeurs font de Wall Street et de l'avidité une priorité, en oubliant les contributeurs essentiels qui font tourner la machine. [...] Si nous ne leurs tenons pas tête maintenant, nous aurons toutes et tous des problèmes. Nous allons toutes et tous nous retrouver sous la menace d'être remplacé·es par des machines." Interrogé par Deadline, un membre du syndicat des comédien·nes déclarait que "les acteurs et actrices ont vu Joan is Awful comme un documentaire sur le futur, dans lequel leurs silhouettes seraient vendues et exploitées comme les producteurs et les studios le souhaitent. Nous voulons des garanties solides. Les studios nous ont rétorqué : «faites-nous confiance». Nous ne leur faisons pas confiance." La panique de l'IA s'invite sur les plateaux de tournage.
Comme pour les autres secteurs de l'économie angoissés par la diffusion des outils d'automatisation (c'est à dire à peu près tous, de la creative class aux artisans, ouvriers, médecins, profs, etc), la déclaration de Fran Drescher mérite d'être rectifiée : ce ne sont pas "les machines" qui vont remplacer "les humains" mais le patronat qui, depuis les premiers théorèmes d'Adam Smith, tente éternellement d'accaparer les nouveaux outils de production pour optimiser l'extraction de la force de travail des employé·es dans le but de maximiser les profits réalisés. De la machine à vapeur à l'IA générative, (presque) rien n'a changé sous le soleil rouge de la lutte des classes, excepté le degré d'efficacité et de violence du processus. "La grève, comme toutes les grèves, est une question d'argent. c'est aussi fondamentalement une question technologique", résume The Atlantic. Plus exactement, c'est un rapport de force autour de deux visions de l'usage de l'outil. Et celle des studios commence à être claire.
Côté acteurs, le combat contre l'utilisation dérégulée de doubles numériques a commencé il y a presque un quart de siècle, en 1999, lorsque Ridley Scott utilise différentes techniques pour "terminer" le rôle d'Oliver Reed, décédé sur le tournage de Gladiator. Depuis, un club impressionnant d'acteurs et actrices légendaires a été ressuscité grâce aux effets spéciaux, et la pratique se généralise un peu plus chaque année à Hollywood. Carrie Fischer a joué la princesse Leia dans un Star Wars tourné après sa mort. Paul Walker, mort en 2013, a eu droit à une séquence d'adieu post-mortem dans Fast and Furious 7. Un Harrison Ford de 80 ans a joué un Indiana Jones de 35 ans dans Le cadran de la destinée, sorti il y a quelques semaines. Des entreprises comme Digital Domain, responsable des effets spéciaux de blockbusters colossaux comme Avengers : Infinity War, "scannent" les acteurs et actrices qui espèrent une immortalité factice. Et il n'y a pas que les visages : Hollywood génère désormais des voix, comme celle du chef cuistot Anthony Bourdain, pour insérer des citations inédites (et fausses) dans des documentaires. Sur les superproductions, les effets spéciaux sont sous-traités à un archipel d'entreprises, de plus en plus souvent délocalisées dans les pays du Sud, où les contremaîtres des studios comme Marvel peuvent imposer des cadences infernales et une pression psychologique constante sans avoir à craindre un mouvement social, puisque la division des tâches empêche l'union des revendications.
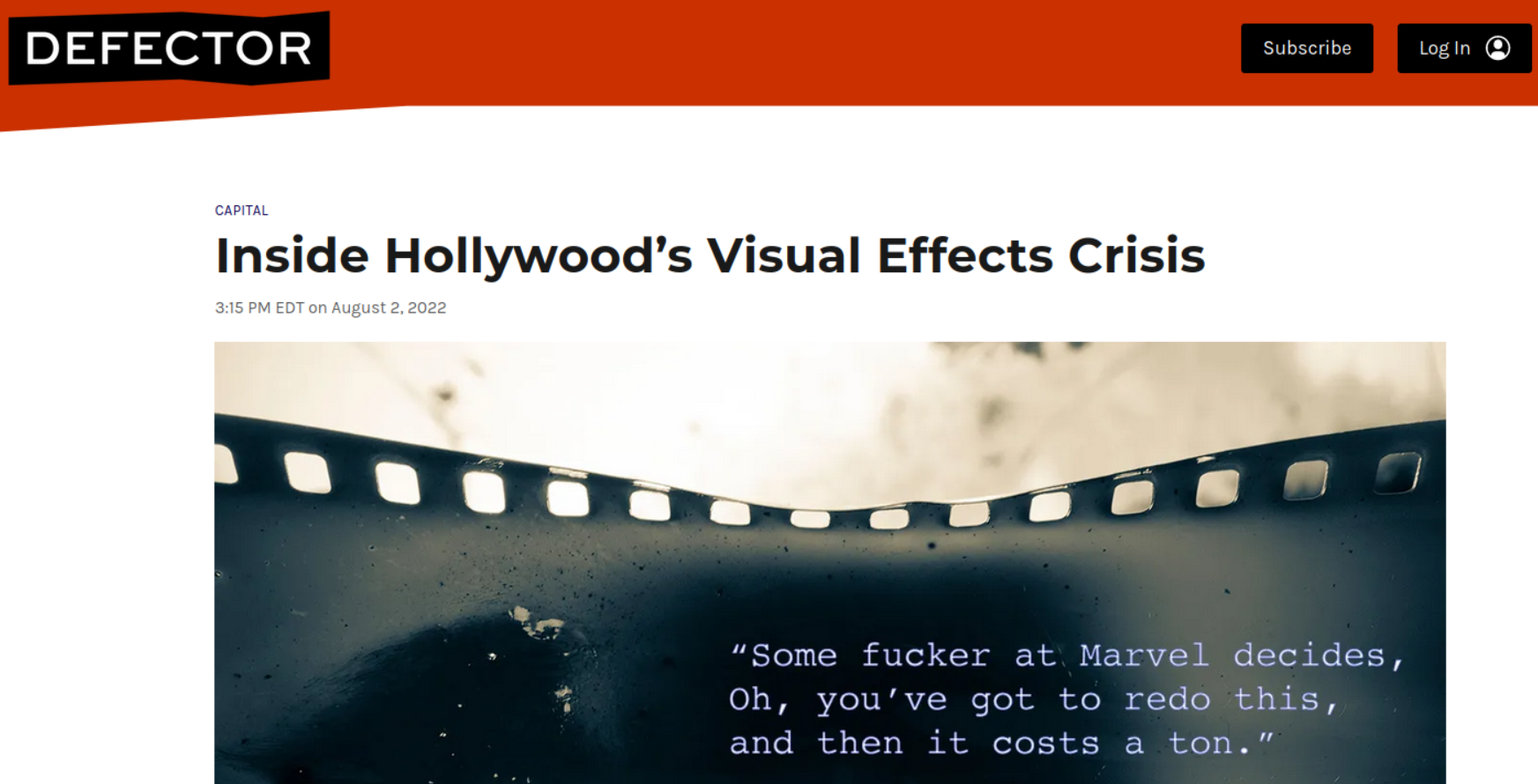
Les superstars vieillissantes ou décédées ne sont évidemment pas les premières victimes de la cupidité des studios. Sur la ligne de front, ce sont les silhouettes, ces acteurs et actrices d'arrière-plan, le plus souvent muet·tes, qui trinquent. Le 13 juillet, le négociateur en chef du SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland révélait que les studios avaient proposé que ces acteurs et actrices d'arrière-plan soient "scannés, payés pour un jour de travail, et que les entreprises puissent posséder leur scan, leur image, et qu'elles puissent l'utiliser pour toute l'éternité, sur n'importe quel projet, sans consentement ni compensation." Un scandale. Le lendemain, Justine Bateman, également présente aux négociations, révélait que les studios avaient pour plan de "fournir cent ans de performances d'acteurs et actrices (achetées en une fois) à leurs systèmes d'IA génératives pour les entraîner", afin de créer une génération d'acteurs et actrices entièrement synthétiques. Selon le syndicat, 87% de ses membres, ces acteurs sans noms ni visage, gagnent moins de 26 000 dollars l'année. Loin du star system, ce prolétariat du cinéma gagne, selon le syndicat, de 187 à 219 dollars par jour. Pour Universal, Warner, Netflix et les autres, le vol d'un visage vaut donc 200 dollars. Et là, est-ce qu'on serait pas "en plein dans Black Mirror" ?
Il n'existe pas encore d'exemple de série ou de film entièrement produite ou écrite par une IA générative, mais on se rapproche. La "démonstration", le 20 juillet, d'un supposé logiciel d'IA, SHOW-1, soi-disant capable de générer des épisodes de South Park, a été accueillie avec méfiance par la communauté de l'IA, et avec une rage palpable (et compréhensible) par les scénaristes, tandis que la salive coulait probablement des lèvres des patrons de studios. Les producteurs ne se privent pas d'utiliser les outils actuels, aussi limités et balbutiants soient-ils. Chez Disney, la séquence d'introduction de la série Marvel Secret Invasiona été générée par de l'IA, apprenait-on le 22 juin. En février, Netflix révélait que le court-métrage d'animation de trois minutes Dog and Boyavait été réalisé grâce à un système de génération d'image automatisé, prétendument pour pallier "une pénurie de travailleurs". Un essai visiblement concluant puisque le studio a publié, le 26 juillet (en pleine grève, donc), une offre d'emploi pour un responsable produit en IA avec un salaire annuel de... 900 000 dollars. Comme tous les grands studios, qui vivent actuellement une "fièvre d'embauches discrètes" dans le secteur de l'IA, alors que le reste de l'industrie subit des plans de licenciement. Le 4 mai, alors que la grève des scénaristes débutait, plusieurs cadres des grands studios se réunissaient pour une conférence sur la question. Sans contenir leur excitation. Pour eux, l'IA écrira des scénarios "d'ici un an", et s'étendra progressivement "au montage, puis à tout le reste". Au terminus de la lutte des classes, une industrie du spectacle entièrement automatisée. Car comme le disait Bob Iger, PDG de Disney, en novembre dernier, "rien n'arrêtera le progrès technologique." Étrangement, personne ne se pose la question d'appliquer le fameux progrès technologique au top management, et de remplacer les PDG par
des IA génératives. La piste mériterait pourtant d'être explorée par les cost killers en quête permanente de rentabilité : aux États-Unis, osait The Hustle, le salaire moyen d'un PDG équivaut à celui de 399 employés médians (20 contre 1 en 1965).
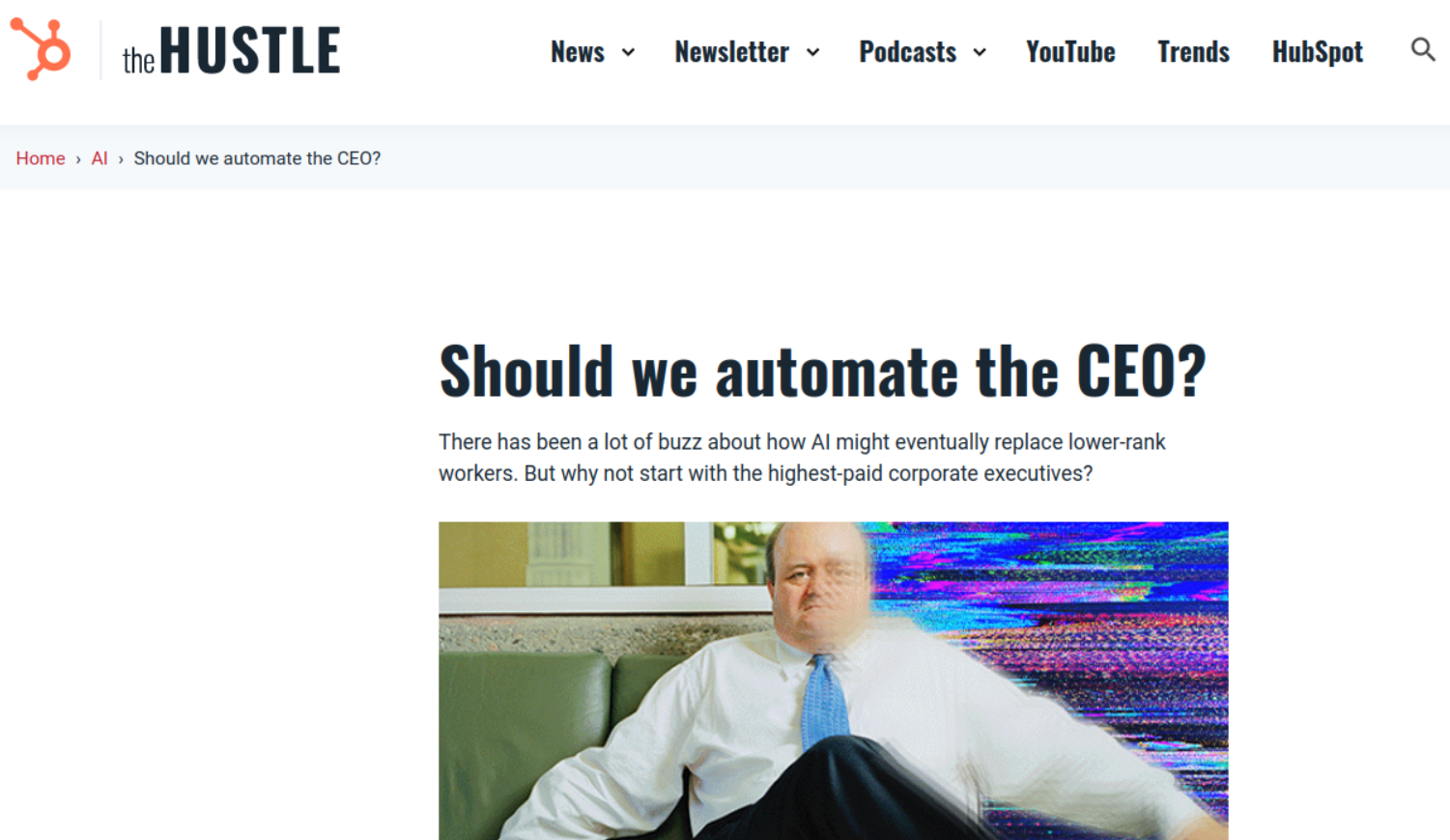
C'est au nom du progrès technique qu'année après année, nouveau média après nouveau média, le patronat d'Hollywood paupérise, fragmente et accapare les profits du labeur de ses ouvrier.es, tandis que lui-même consolide sans cesse ses conglomérats. Toutes les grèves d'Hollywood, explique le journaliste Jonathan Handel (auteur d'un livre sur le sujet) à Vulture, "ont été liées au changement technologique. Des changements qui, dans la plupart des cas, ont résulté en désaccords à propos du type de compensations à payer et comment elles devraient être calculées." Un exemple : lors de la négociation de ces compensations dans les années 80, la WGA avait accepté que 80% des recettes des cassettes VHS partent au studio, car ce format alors nouveau était encore cher à produire. Malgré un effondrement des coûts de production et l'irruption du DVD, le contrat n'a jamais été mis à jour, et la WGA a ainsi perdu d'énormes sommes d'argent pour ses membres. De l'abandon de la pellicule celluloïd au streaming, un même continuum de lutte pour obtenir son dû, explique brillamment Paris Marx dans sa newsletter Disconnect.
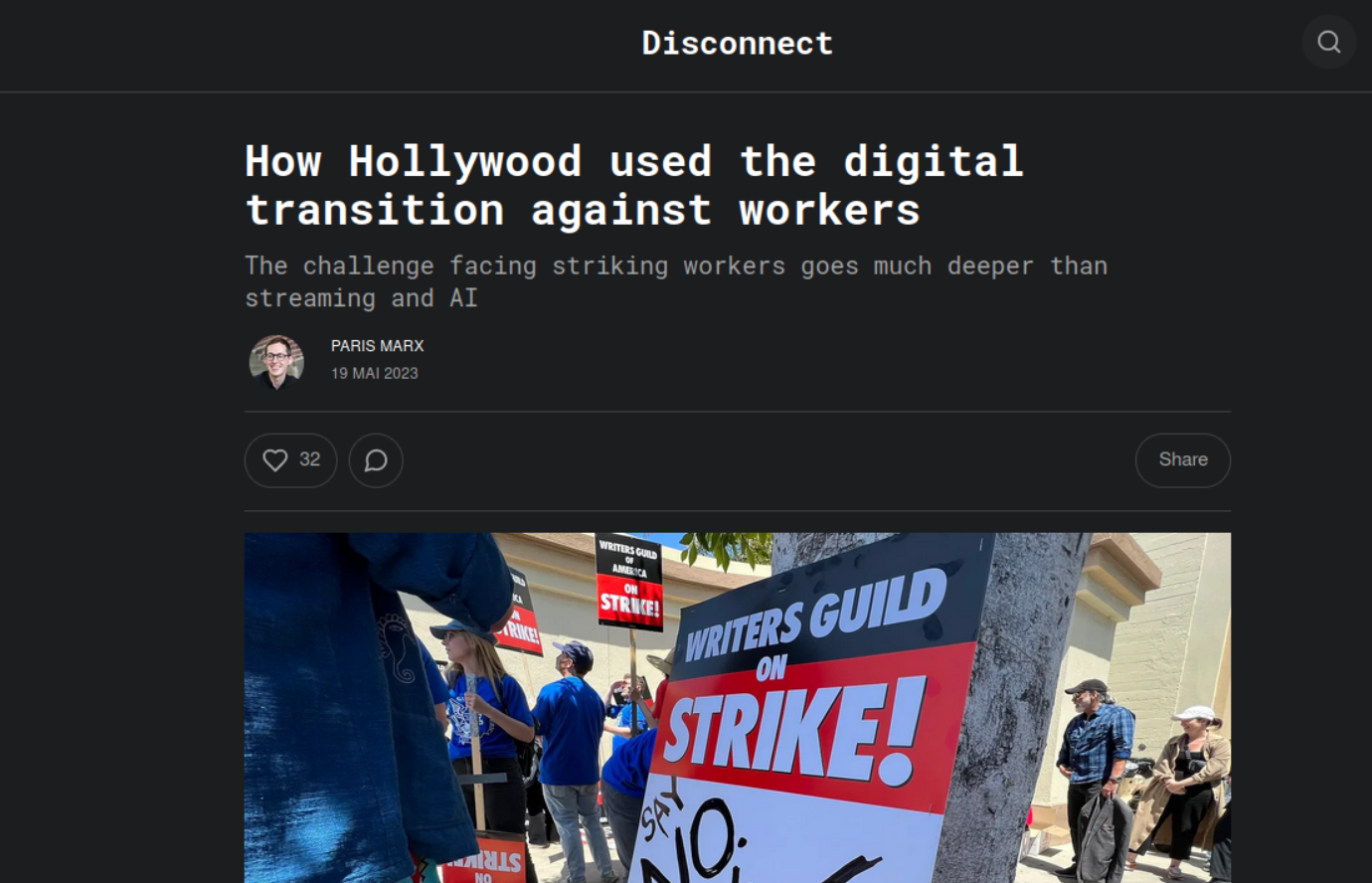
La lutte actuelle des scénaristes ne réclame pas autre chose : plus de scénaristes par production, des heures décentes, plus de sécurité de l'emploi et une redistribution digne des profits générés. Avec le streaming, explique le syndicat, "l'attitude des entreprises a créé une économie de tâcherons dans une main-d'oeuvre syndiquée .(...) De leur refus de garantir le moindre niveau d'emploi hebdomadaire dans la télévision épisodique à la création d'un «tarif journalier» dans la comédie, dans leur entêtement à faire travailler gratuitement les scénaristes et à imposer l'IA, ils ont (...) ouvert la porte à une profession d'auteur entièrement freelance." Les studios, eux, assurent que le streaming a détruit leurs marges. En 2021, David Zaslav, PDG de Warner Discovery, était pourtant considéré comme le patron le plus surpayé au monde, avec un salaire annuel de 246 millions de dollars, dont 232 millions en actions. Avec des profits annuels autour des 30 milliards de dollars combinés, l'industrie audiovisuelle va très bien, merci pour elle.
Elle va même d'autant mieux qu'elle recycle la méthode de ses voisines californiennes de la Silicon Valley, en appliquant progressivement un capitalisme dit "de plateforme", que l'économiste et ex-ministre des Finances grec Yanis Varoufakis (cité par l'indépassable Cory Doctorow) appelle désormais "techno-féodalisme". Selon lui et d'autres, nous vivons désormais dans une économie dominée non plus par le capital mais par la rente : les entreprises ne créent pas de valeur, elles se concentrent jusqu'à obtenir un monopole, puis déploient des systèmes d'intermédiation numérique -une application, un site- pour capturer (gratuitement ou presque) la valeur produite en amont par d'autres, avant de la revendre au prix fort aux utilisateurs/consommateurs. Pensez Uber, l'entreprise de taxis sans taxis ; Airbnb, l'hôtelier sans hôtels ; Spotify, le diffuseur de musique sans label ni studio ; Facebook et Google, des régies publicitaires géantes qui fonctionnent sur la production gratuite de contenus par les internautes, etc. Dans un tel système de monopoles et de dépendances, les rapports de domination ne sont plus ceux de l'ouvrier et du patron, mais ceux du serf et du suzerain. La caste bourgeoise a laissé place à la caste vectorialiste, écrit Mackenzie Wark dans Capital is Dead. Et la production, écrivait l'économiste Cédric Durand en 2020 dans son livre Techno-féodalismes : critique de l'économie numérique, a laissé place à la prédation.
C'est dans ce contexte de mutation destructrice que débarque l'IA générative, nouvel outil dans l'arsenal extractiviste des parasites de l'économie. Partout où elle s'invite, le même système d'exploitation totale est proposé : récupérer l'ensemble de la valeur produite par des humains pour s'entraîner à (mal) l'imiter, puis remplacer des savoirs-faire irremplaçables par une production d'ersatz à la chaîne. C'est notamment ce que propose Google, qui fait discrètement le tour des rédactions étasuniennes pour proposer Genesis, son IA "journaliste", entraînée sur les millions d'articles que Google vole et diffuse sans rémunérer personne. Dans le récit déclamé par l'industrie et la finance, l'IA générative préfigurerait une sorte de nouvelle Révolution industrielle, un changement de paradigme technique si radical que la tectonique même des rapports de production en serait chamboulée à jamais. À Hollywood comme ailleurs, nous avertissent ses prophètes, toute résistance serait inutile.
Penchons-nous, alors, sur cette période stratégique de l'histoire des luttes sociales, mythe fondateur de l'économie de marché triomphante et de la supposée supériorité technique et économique de l'Occident. Et rappelons, comme The Economist (pourtant pas exactement un brûlot anticapitaliste), que la Première révolution industrielle anglaise (1760-1850), celle des machines à vapeur, enrichit aussi formidablement les nouvelles élites industrielles qu'elle paupérisa des millions d'artisans et travailleurs qualifiés, dont les organisations syndicales furent démantelées par le gouvernement britannique. Les salaires stagnèrent pendant des décennies et n'augmentèrent réellement qu'à partir de 1840. Pour plusieurs générations de britanniques, la qualité de vie s'effondra. C'est parmi ces travailleurs qualifiés déclassés par un nouveau système économique, ceux de l'industrie textile, que naît la figure du "roi Ned Ludd", porte-parole allégorique du mouvement Luddite. De 1811 à 1813, les Luddites mènent des actions de sabotage contre "les machines préjudiciables à la communauté", avant d'être matés dans le sang par 14 000 soldats, appuyés par une loi faisant du sabotage de machine un crime puni de mort. Avec le temps, l'hégémonie du récit capitaliste sur la perception collective de l'Histoire a mené à une forme de diabolisation du mot, et le Luddite est devenu cette personne technophobe et réactionnaire, incapable de vivre avec son temps – une insulte, comme les "Amish" de Macron, pour qui le matérialisme historique se résume à choisir entre Uber et la charrette à boeufs.
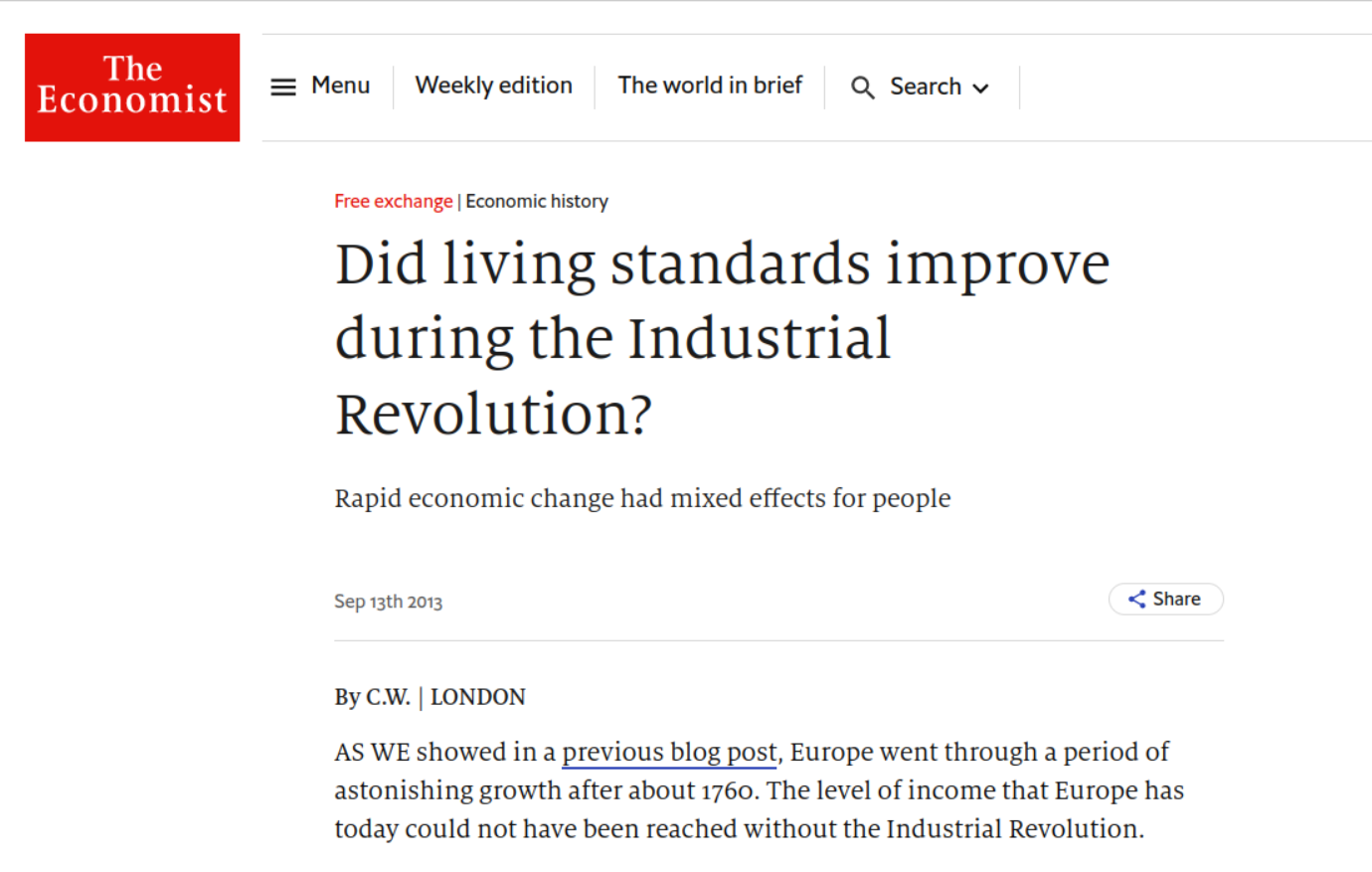
À l'heure où l'histoire s'écrit à nouveau chez les scénaristes d'Hollywood, il est plus que temps de réhabiliter leur stratégie et leur radicalité politique. Car les Luddites, loin d'être de simples casseurs de machines, savaient précisément ce qu'ils faisaient : ils luttaient, affirme l'historien David Noble dans Progress without People, contre le processus visant à faire passer "le contrôle de la production dans le bureau des ingénieurs" et des managers, loin des ouvriers qui les utilisent. À la radicalité techno-solutionniste des patrons, construite sur une vision idyllique du progrès (et des bénéfices) à venir, les Luddites opposaient une radicalité communautaire et locale, préexistante à la classe ouvrière marxiste, qui refuse la supposée neutralité politique de la machine et comprend immédiatement le projet politique et social qu'elle contient – et ses conséquences délétères sur la qualité de vie de tous.
Le sabotage s'inscrit alors dans un éventail de techniques militantes (notamment des pétitions pour interdire le travail des enfants) qui opposent à la réécriture patronale du temps une technique du présent, bénéfique au quotidien de la communauté. Mais pas d'inquiétude, claironnent les économistes libéraux, 140 ans de données à l'appui, car on sait désormais que l'innovation technique crée plus de boulots qu'elle n'en détruit. Faut-il vraiment se réjouir de troquer des métiers hautement qualifiés contre les boulots à la tâche, répétitifs et toxiques, de ce "prolétariat de l'IA" étudié par Antonio Casilli et superbement cartographié par Rest of World ? De rejoindre cette armée fantôme dont on ignore la taille réelle, qui hante les pays du Sud (et s'étend désormais aux États-Unis) et inlassablement labellise, vérifie, corrige, filtre le contenu toxique et surveille les IA génératives, pour 1,50 dollars de l'heure et jusqu'au syndrome de stress post-traumatique ? Voulons-nous revivre le destin des tisserands du Yorkshire prolétarisés de force au nom de la rationalité productiviste, mais le faire cette fois-ci en souriant?
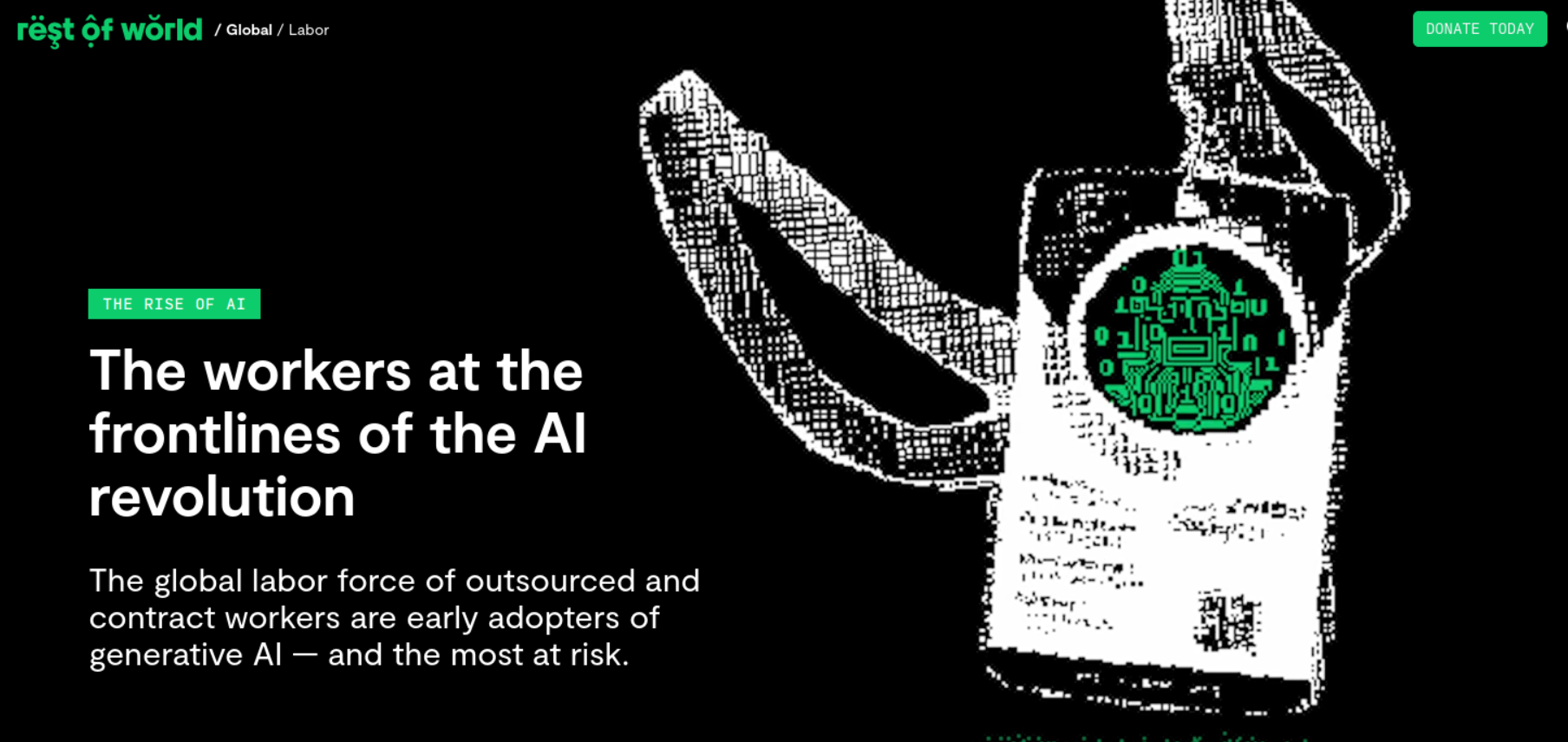
De tous temps, expliquait l'historien François Jarrige à l'Obs,"ce qu’on appelle «innovation» est la condensation de rapports de force et de représentations culturelles", et de nombreux mouvements de résistance aux machines, y compris en France avec les camarades dactylo-codeuses de l'Insee en 1981, ont perpétué l'héritage luddite jusqu'aux années 90 avant d'être rapidement effacés de l'histoire. Mais contrairement aux machines d'antan, les outils d'exploitation contemporains ont su se dématérialiser, se rendre indispensables, s'enchevêtrer avec nos vies, pour mieux s'imposer. Les néo-luddites d'Hollywood et d'ailleurs ne pourront pas casser l'IA à coups de masse, mais d'autres approches existent. La grève, évidemment ; les recours collectifs en justice, qui attaquent actuellement tous les producteurs d'IA générative (Stable Diffusion, OpenAI, Google, GitHub, etc.) pour vol de propriété intellectuelle et collecte massive de données personnelles ; la pression sur les pouvoirs publics pour démanteler ces monopoles et les dépendances qu'ils créent ; l'action directe, comme celle du collectif Safe Street Rebels, qui neutralise les taxis autonomes Waymo en leur plantant un cône de chantier sur le capot. L'auto-organisation, enfin, dans des structures collectives autonomes libérées du techno-cocon, comme la Zad ou la commune. Dans Le Capital, Marx écrivait qu'il "faut du temps et de l’expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d’exploitation." Cette distinction semble aujourd'hui dépassée : à l'heure du techno-féodalisme et de l'extractivisme total, cette machine-là, opaque et immatérielle, ne sera jamais un outil d'émancipation collective. Néo-luddites de tous les pays (et d'Hollywood) : unissez-vous !
